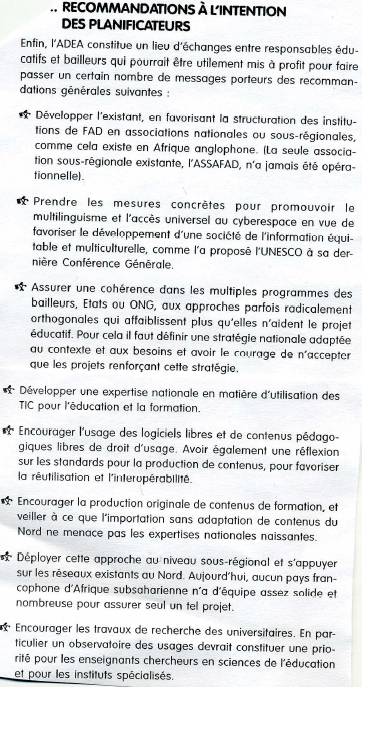
Comme le souligne un auteur, Patrice Flichy1 : «Chaque grande innovation technique s’est accompagnée d’un discours utopique sur les bouleversements sociaux qu’elle allait engendrer. C’est le cas d’Internet qui véhicule lui aussi son lot de rêves et de peurs en matière de communication. Ces mythes ne sont pas simplement des idées fausses : ils participent à la mobilisation des acteurs, à la construction et à la diffusion de la technique elle même». Ainsi tout au long de cette étude, il nous aura fallu faire la part des discours, fussent-ils bien intentionnés avec la réalité des pratiques rencontrées. Les auteurs de l’étude durent ainsi se positionner entre le discours des prescripteurs et ses représentations pesantes, le turn-over technologique et la difficulté d’analyse des pratiques réelles de formation … Les nouvelles technologies, et particulièrement Internet, restent à la mode et engendrent une communication tous azimuts, où l’éducatif est souvent mis en première ligne . La dimension politique est évidente. L’exemple du Sénégal est révélateur, le président Wade s’investit personnellement, une foule impressionnante l’accueille entre l’aéroport de Dakar et son palais au retour du Sommet Mondial de la Société de l’Information en 2004 à Genève, les accords états /Microsoft sont présentés à la une de la presse. Un lieu commun est aussi observable dans les discours, il porte sur la « facilitation de l’acte d’apprentissage », un argument récurrent, même si il est contestable, utilisé aussi bien avec l’opinion publique qu’auprès des enseignants. Si cette représentation s’érode au Nord, elle reste dominante au Sud. Pourtant, la fausse croyance à la simplicité d’usage « entraîne des représentations inadéquates qui provoquent la déception rapide de certains enseignants utilisateurs » (Duchateau 1999) »
Il existe aussi des phénomènes de mode terminologique qui contribuent au brouillage du débat. Cette inflation terminologique et conceptuelle trouve son origine dans la rapidité des changements technologiques, mais aussi dans le fait que certains prescripteurs ou chercheurs estiment souvent que le recours aux paradigmes de l’enseignement présentiel présente peu d’utilité.
Les pratiques personnelles ou sociales des enseignants intègrent de pus en plus t l’usage d’Internet pour les communications et la recherche documentaire. Des formes nouvelles de collaboration interpersonnelles sont en émergence dans la préparation de cours en particulier. Comme on l’a déjà souligné, si l’instituteur de village est encore loin des technologies, les enseignants urbains sont comme tous les jeunes des utilisateurs des cyber-cafés ou des postes de consultation présents dans les universités. MAIS TOUT CECI EST DIFFICILEMENT MESURABLE ;
Il nous semble évident que la reflexion sur l’enseignement à distance et l’apprentissage libre ne peut, quel que soit le contexte géographique se limiter aux questions qui précèdent, c’est plus généralement le rapport entre TICE et sytème éducatif qui est posé.
.La dimension comparative, toujours nécessaire, s’inscrit dans une double dimension . En premier lieu spatiale, par l’approche des autres systèmes éducatifs (inscrits dans leurs systèmes éducatifs respectifs, en particulier les pays où la connexion des établissements scolaires est développée (Amérique du Nord, Europe du Nord, pour pour les pays d’Afrique Saharienne, une comparaison avec les pays latino ou du Sud est asiatique est pertinente. Au Ghana, le taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur stagne depuis 1960 à moins de 2% d’une classe d’âge, il est passé en Corée du Sud de 4à 80% (source BM)
Mais la dimension temporelle, quasi patrimoniale parfois, est aussi indispensable : celle de l’étude des tentatives passées d’introduction de nouvelles technologies, car certaines questions qui semblent contemporaines ne sont de fait pas nouvelles. Jusqu'à aujourd’hui, l'audiovisuel et plus récemment l’informatique, dans l’éducation, c'est comme les marées sur l'océan. Hypothèse : En admettant que les introductions des technologies audiovisuelles puis première vague informatique puis satellitaire furent des impasses… que dire des modes de formation académiques ? La modestie des taux de scolarisation, la crise des systèmes éducatifs ne plaident pas, non plus, en leur faveur.
En 2001 une précédente étude pour l’ADEA se concluait par une série de recommandations ou questionnements…
Ainsi (page 67 de l’étude) la question des couts de l’introduction des TICE et de la FAD dans un système éducatif était-elle posée. Il nous faut constater que cette question reste récemment évoquée : tabou ou absence d’indicateurs pertinents ? Cette question reste pourtant centrale.
Pas plus que dans les pays du Nord, l’approche pédagogique sur les NTIC ne se suffit à elle même. Elle s’inscrit dans une dimension systémique qui touche les politiques institutionnelles, les relations internationales, le développement durable.
8 recommandations étaient faites aux planificateurs, elles restent globalement d’actualité, même si, par exemple la cinquième qui portait sur les logiciels libres est contrariée par un certain nombre de tendances observables : tel l’accord Microsoft/Sénégal, fin 2004….
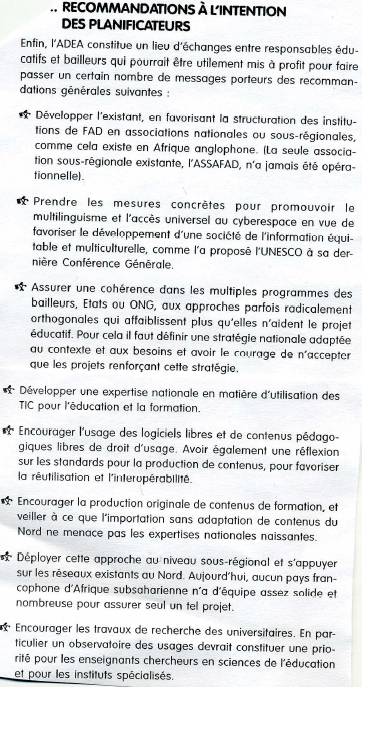
Dans la présente étude, 6 pays sont étudiés et une dizaine d’études de cas sont présentés. Le champ de recherche aurait certes pu être enrichi, mais les pays choisis nous semblent représentatifs en matière de technologies pour l’éducation… Entre le Sénégal où la volonté politique est évidente et d’autres états moins conscientisés dans ce domaine, nous avons conscience que les écarts sont grands, mais nous pensons aussi que les problèmes et les leviers pour éventuellement résoudre ces problèmes sont le plus souvent commun. C’est autour de 9 points leviers ou topiques issus d’une première phase de synthèse qu’un travail collaboratif a été mené (février/mars 2005) par les auteurs des six études pays. Nous avons reproduit des extraits significatifs de leurs contribution.
A quel niveau concret se situe l’engagement des autorités en matière d’EDAL ?
La cohabitation de plusieurs organismes et institutions plus ou moins déclarés en charge du développement des TIC ne constitue pas a priori un indicateur concret d'engagement. Pour situer un niveau, il semble nécessaire préalablement d'en fixer des critères objectifs de mesure. En ce qui concerne l'engagement des autorités politiques nationales, les critères pourraient être :
En ce qui concerne le Bénin, le niveau se situerait alors entre le 2 et le 3. Des textes officiels expriment la volonté de développer le secteur des TICE dans les trois ministères du secteur de l'éducation au Bénin. Une tarification préférentielle existe pour la liaison spécialisée des établissements scolaires. Des centres de ressources existent à Porto-Novo, Cotonou et Abomey-Calavi mais tous sont le résultat d'une initiative et d'un appui de projets de coopération et les ressources humaines nécessaires à leur animation et leur rayonnement sont insuffisamment nombreuses et définies.
Bénin
Aujourd'hui au Gabon, c'est clairement l'Etat qui est le principal moteur du développement des technologies dans le pays. D'une part, c'est indispensable pour lancer le mouvement. Mais on sait bien que l'innovation ne se décide pas par décret, aussi il reste encore beaucoup de travail à faire auprès des enseignants et des chercheurs pour qu'ils s'approprient ce genre de dispositif. Les enseignants sont mieux désignés pour développer les usages, pas l'Etat.
A l'heure actuelle, il n'existe pas d'institution spécifiquement responsable du développement des TIC au Gabon. Le Président met ce domaine sous sa propre responsabilité. Le Conseiller informatique de la Commission nationale d'informatique rattachée au Cabinet présidentiel est le point focal de RINAF (Réseau régional africain d'informatique) et le coordinateur sous régional pour l'Afrique centrale. RINAF est un projet de l'UNESCO .
L'ARTEL, autorité administrative placée sous la double tutelle du Ministère de la Communication, des Postes et des Technologies de l'Information, ainsi que du Ministère de l'Économie et des Finances, assure la régulation, le contrôle, le suivi des activités des exploitants et opérateurs du secteur des télécoms.
Avec l'aide de diverses institutions internationales (PNUD, UNESCO, Coopération Française, Agence Canadienne de Développement International, etc.), le Gabon, à mis sur pieds divers projets et études qui devaient prendre en compte les priorités gouvernementales en matière de communication et d'information. Notamment, le projet info-com (http://www.infocom.gouv.ga) visant à aider le pays à définir sa stratégie d'information et de communication en incluant des facteurs comme la démocratie et la relance économique. Mais malgré toutes les études et les projets qui avaient comme principal sujet " les nouvelles technologies d'information et de communication au Gabon ", le domaine de TICE avance très peu. Le Gabon compterait environ 25 000 micro-ordinateurs, soit 1 pour 50 habitants. Dans ce contexte particulier, nous pouvons avancer sans hésiter qu'il n'y a pas de réelle volonté de politique de l'EDAL au Gabon. Les décideurs politiques et économiques du Gabon acceptent et accompagnent timidement mais avec beaucoup de réserves la mise en œuvre d'opération et de projets concernant ce domaine beaucoup plus pour l'image internationale que cela leur confère que pour les opportunités induites par ces nouvelles technologies, encore non perceptibles à leurs yeux.
Gabon
.L es intentions ne manquent pas en matière d'utilisation des TIC, surtout au niveau de la planification éducative, mais les engagements concrets ne sont pas encore visibles. Il semble donc qu'ici le niveau concret se situe au niveau ministériel.
Le Ministre de l'éducation souligne sans arrêt que la mise en place d'une planification éducative ne pourra se faire sans un minimum de compétences informatiques et de traitement numérique des données. Malheureusement les personnes concernées n'ont pas accès à un ordinateur et encore moins à Internet.
En ce qui concerne l'EDAL, le paradoxe de ce pays est qu'il n'y a pas de réelle volonté politique et c'est pourtant un des territoires qui en aurait le plus besoin d'une part pour éviter le cas de figure que l'on rencontre par exemple à l'Ecole Universitaire de formation des professeurs : plusieurs professeurs pour un étudiant (!) et d'autre part de par son découpage géographique où l'EDAL permettrait d'effectuer des échanges entre Malabo (partie insulaire) et Bata (partie continentale). Ainsi par exemple, Bata pourrait envoyer à Malabo des formations à distance qu'elle aurait reçu et réciproquement.
Guinée équatoriale
L'engagement des autorités se situe à deux niveaux essentiellement, des décisions politiques : déclarations générales, mise en place d'un ministère chargé des TIC et d'une Agence de l'Informatique de l'Etat
Sénégal
L’engagement des autorités togolaises se situe au niveau ministériel. Le Ministère de l’Education nationale et celui de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle tentent de traduire dans les faits les orientations définies par le gouvernement en matière d’utilisation de TIC dans l’enseignement. S’il n’existe pas actuellement une direction qui a en charge la mise en œuvre des orientations prise par le gouvernement, certains directions initient des programmes de formation à l’utilisation des TICE dans l’administration et dans l’enseignement.
On peut signaler l’engagement de l’Université de Lomé à travers le Centre Informatique et de Calcul (CIC) et le Centre de Formation à Distance qui font de l’utilisation des TIC dans l’enseignement leurs priorités. On peut aussi signaler les initiatives de formation des cadres de l’enseignement opérées par le RESAFAD-Togo.
Togo
Quelles sont les priorités affichées ? Y-a-t-il un plan d’ensemble reliant l’administratif et le pédagogique dans le domaine des TICE ?
Les priorités affichées sont différentes selon les trois ministères au Bénin.Le ministère des enseignements primaire et secondaire met l'accent sur le développement de l'usage des TICE, notamment dans les établissements.Le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a inscrit dans ses axes stratégiques le développement de la formation à distance. Cela ne signifie pas que cette volonté soit appropriée et relayée par les directions concernées.Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique exprime sa volonté de développer la formation à distance entre les pôles universitaires d'Abomey-Calavi et Parakou, notamment par la visioconférence.Dans aucun des trois ministères, la responsabilité claire et spécifique par une structure identifiée de la prise en charge d'une politique TICE n'est évidente, tant au niveau des directions centrales des ministères qu'au niveau des universités.
Bénin
Au Gabon, il n'existe pas actuellement de plan d'ensemble reliant l'administratif et le pédagogique dans le domaine des TICE. En dehors du plan d'équipement des lycées de 2001 aucune autre initiative visant à promouvoir les TIC dans l'éducation n'a été enregistrée jusque là. Toutefois l'étude de faisabilité réalisée dans le cadre du projet RDD Réseau de Développement Durable Internet (RDD-INTERNET) confirme l'existence d'un parc important d'ordinateurs (30 dans l'administration centrale du ministère de l'Education nationale et 60 dans l'ensemble des établissements de Libreville). Un schéma directeur de l'informatique (plan informatique) du ministère de l'Education nationale est en préparation pour juillet 2006. En prélude à ce plan informatique, des formations (initiation à l'informatique, initiation à la gestion de la carte scolaire…) ont été données aux agents dudit ministère. Ce schéma directeur devrait favoriser la réorganisation des structures et la simplification administrative, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel et des avancements. La production, la diffusion et la circulation de l'information, est envisagée dans le cadre de l'animation de centres de documentation et d'information (CDI) placés dans l'administration centrale et les établissements.
Gabon
En Guinée Equatoriale, il n'existe pas actuellement de plan d'ensemble reliant l'administratif et le pédagogique dans le domaine des TICE.
Les configurations géographiques (une partie insulaire et une partie continentale) et démographique (faible population) imposeront tôt ou tard le recours aux TIC et aux FAD.
Les salles RESAFAD sont supposées être des précurseurs d'une activité de FAD mais ne sont actuellement utilisées que comme outils d'alphabétisation aux TIC .
Guinée Equatoriale
Il n’existe pas de plan d’ensemble visant à relier l’administratif et le pédagogique en matière de TICE. Néanmoins certaines actions de formations privilégient la formation des cadres de l’administration scolaire à l’utilisation des TICE
Togo
Qui sont les décideurs au niveau régional et local, quelles directives ont-ils reçu, quelle est la pérennité des offres, quelles sont les contreparties ? Les partenaires ont-ils un droit de regard ? Comment décliner ces partenariats tant au niveau national qu’au niveau local ? Comment établir un cahier des charges qui tienne compte également des besoins en matière de EDAL ?
Les questions font référence à trois niveaux : local, national et régional. S'agissant des décisionnaires des partenaires potentiels du développement de l'Education en Afrique francophone, leur recensement est difficile au niveau régional lorsqu'on est situé au niveau national. S'agit-il des partenaires de l'éducation ou des partenaires du développement des TICE ?L'état actuel de l'étude inter-pays fait ressortir un certain nombre de ces partenaires : CED-GDLN, UVA, AUF, World-links, etc.
Bénin
La plupart du temps, les offres viennent directement des ONG et autres initiatives privées. Pour assurer la pérennité de leur action elles impliquent l'Etat qui se charge de les subventionner, elles peuvent également contacter des organismes et autres bailleurs pour avoir les fonds nécessaires pour mener à bien leur projet . Le projet pourra ainsi être conventionné par l'Etat mais être autonome et avoir une comptabilité propre.
C'est par exemple le cas du Forum des Amis du Net (http://www.fan.africa-web.org ) , une ONG gabonaise dont le but est de vulgariser l'utilisation de l'outil Internet en milieu jeune et d'aider les jeunes à créer leurs propres emplois. Cette ONG a déjà initié deux projets : "Ruée sur le Net" et le projet "Internet et Education" Ils tournent autour de la vulgarisation de l'outil Internet auprès des jeunes. Des formations sont données aux jeunes afin que ces derniers deviennent à leur tour des formateurs auprès de jeunes novices en informatique.
Gabon
Les principaux partenaires privés du Ministère de l'Education sont la SONATEL et Microsoft.
Dans le cas de la SONATEL, le partenariat est réalisé dans le but de faciliter l'accès à Internet pour les établissements scolaires et les universités. La covention prend en compte les besoins de l'EDAL car elle s'applique à toutes les liaisons Internet (RTC, RNIS, ADSL et LS). La pérennité est assurée par la bonne santé économique de la SONATEL et la reconduction tacite de la convention. Au niveau local les établissements scolaires s'adressent directement à la succursale de la SONATEL.
Concernant Microsoft, il a été signé un protocole d'accord sur les logiciels. Ce protocole permet aux établissements de bénéficier d'un tarif réduit sur toute la gamme de produits Microsoft. Le protocole prévoit aussi un appui de Microsoft sur la formation des personnels de l'éducation à l'usage des technologies ainsi que le développement de contenus éducatifs. Le protocole n'est pas encore opérationnel (au 10 mars 2005), il reste à définir les modalités d'application .
Sénégal
Les technologies audio-visuelles ont-elle été abandonnées ? Pourquoi ? : Préalablement, pour chaque pays, il faudrait se demander si les technologies audio-visuelles ont été réellement utilisées, avec quels résultats et impacts, évalués et enregistrés. Des expériences sont connues dans différents pays, tant pour la télévision ou la radio. Si l'évolution actuelle de la télévision africaine semble oblitérer toute forme d'emploi à des fins éducatives, les usages de la radio sont d'actualité, par leur capacité à atteindre un grand nombre de personnes en des zones inaccessibles régulièrement par d'autres médias
Les coûts d'utilisation et de maintenance de l'audio-visuel analogique ont sans doute rapidement compromis tout espoir de généralisation. Le rendement économique des technologies numériques por l'audio-visuel est encore mal apprécié. Une hypothèse est aussi que l'engouement pour les formes les plus simples des TIC (courrier, web) porte une ombre sur la nécessité de développer des contenus sur des supports audio-visuels, adaptés aux objectifs sur des publics « a-numériques » : l'arborescence cache la forêt des récepteurs ?
Bénin .
En ce qui concerne la Guinée Equatoriale, la population est passée très brutalement de l'agriculture à l'ère de l'informatique et d'Internet et n'a pas eu le temps d'intégrer les technologies audiovisuelles. Il n'y a donc pas d'abandon, mais un simple rejet du fait que l'audiovisuel n'ait pas participé à son processus de développement technologique. Peut-être est-ce également une des raisons qui peut expliquer la quasi-absence de l'évocation de cette technologie dans les contributions des autres pays.
Guinée équatoriale
Au Sénégal les technologies audiovisuelles n'ont pas réellement été très présentes. On note l'expérience de la radio scolaire CLAD, selon DIENG P. Y. ,DIOP A. et DIOUF A. M. (2004), « … cours publics d'enseignement à distance les plus formalisés sont apparus au Sénégal quelques années après l'indépendance avec l'institution du Centre de Linguistique appliquée de Dakar (CLAD). Cette méthode était destinée à l'amélioration de l'apprentissage du Français par la Technique audio-visuelle. Les écoles élémentaires étaient équipées de radios réceptrices d'émissions à partir de la station-mère. Les maîtres ont reçu une formation portant sur la transmission de contenus avec l'utilisation d'un tableau feutre et de figurines. La méthode portait sur des acquisitions globales qui améliorent sensiblement le français parlé des élèves ; mais il n'en est pas de même pour le français écrit et les règles grammaticales. Des débats pédagogiques souvent passionnés ont opposé partisans et adversaires du CLAD qui, finalement, fut abandonné pour ne subsister que sous la forme d'une unité de recherche linguistique de la Faculté des Lettres. »
Sénégal
Au Togo, l’audiovisuel a été abandonné non pas pour des raisons d’efficience mais parce que le programme de formation qui a privilégié son utilisation n’a pas continué de bénéficier du soutien financier nécessaire compte tenu de la situation sociopolitique qui a prévalu dans les années 1990. Il s’agit du Programme de Télé-enseignement qui a permis la formation et le recyclage de milliers d’enseignants en poste.
Togo
Quels sont les obstacles à contourner pour qu'un programme initié par telle ou telle aide puisse être soutenu par une autre aide ou émarger au budget national ?
Bénin
Historiquement de nombreux projets ne se sont pas maintenus faute d'un engagement réel du gouvernement. Il est donc primordial que le gouvernement soit impliqué dans tout projet afin qu'il le soutienne et assure sa pérennité. Toutefois la lenteur du gouvernement gabonais pour la prise de décisions endogènes étant connue, il serait possible de passer par les syndicats des enseignants les plus représentatifs, le Syndicat de l'éducation nationale (SEENA) et la Fédération syndicale des enseignants de l'éducation nationale, (FESENA) qui au Gabon, exercent toujours des pressions auprès du ministère de l'Education nationale pour l'exécution de certains programmes. L'autre possibilité sera d'associer un Institut comme l'Ecole Normale Supérieure de Libreville (ENS) qui va se charger de la cogestion du projet et pourra ainsi persuader les décideurs afin que le projet émarge dans le budget de l'Etat. Par la suite l'ENS pourra envisager de vendre des formations aux différents ministères intéressés.
Gabon
Quatre éléments qui me semblent importants pour la pérennité des programmes :
Sénégal
A notre avis, les institutions doivent dans leur stratégie :
Il n'est pas rare d'observer de la part des organismes de formation une volonté de développer de nouveaux marchés en demandant aux formateurs d'investir ces nouvelles modalités de formation, sans leur en donner les moyens ou en pensant que cela change peu de choses au regard de ce qu'ils faisaient déjà. C'est à notre sens une erreur d'appréciation qui risque de voir arriver sur le marché des actions de formation à distance qui n'en auront que le nom. Car c'est aussi là une réalité : tous déclare faire de la FOAD, vu les contours encore très flous du sujet, mais toutes les actions montrent-elles un réel investissement financier, technique et pédagogique dans la mise en œuvre de ces dispositifs ? Encourageons cependant, les institutions ont eu le mérite d'expérimenter des situations encore balbutiantes et sont quelque part aujourd'hui les pionnières de la distance
Sénégal(2)
La formation des formateurs en EDAL est-elle opérationnelle ? Comment ?
Cette formation n'est pas inexistante mais elle est disséminée, non intégrée dans une politique de développement de compétences de l'institution éducative. Des cadres suivent ponctuellement des formations proposées par un nombre très réduit de partenaires de l'éducation en Afrique francophone (AUF avec le DESS-tice, Resafad avec le DUCM). Ces formations ne sont encore jamais l'initiative des ministères qui, dans le meilleur des cas, valident ces acquis en confiant aux personnes formées de nouvelles fonctions pour le développement des TICE.
Bénin
Au niveau de RESAFAD-Sénégal deux cas de formation de formateurs en EDAL : cas de la formation à distance des chefs d'établissement et formation à distance des vacataires. Les éléments de réussite ne tiennent pas compte de l'existence des cybre-café mais l'accès aux TIC est garanti au niveau du centre de ressource RESAFAD (lieu de formation) et de l'ENS. Nous constatons que les formateurs ont besoins de revenir au centre RESAFAD malgré un accès garanti au niveau de leur établissement. Il semble qu'un centre de ressource renfermant des ressources humaines susceptibles d'offrir un appui techno pédagogique aux formateurs est un facteur de réussite.
Sénégal
Existe-il une forme de partenariat meilleur qu'une autre ? Quelles sont les conséquences de « l'importation » de formation ou de contenus de formation sur les acteurs de l'enseignement supérieur ?
Il faudrait d'abord recenser clairement les formes de partenariat : diplômation nord, co-diplômation. Il faut ensuite, dans un contexte donné, apprécier ce qui est possible et judicieux. La diplômation nord peut constituer un élément de sensibilisation et d'information dans un contexte où les ressources humaines sont inaptes à collaborer à la production mais où les acteurs prendront conscience des enjeux et observeront les méthodes et les techniques à développer.La co-diplômation permet de conserver la valeur nationale, de l'associer au processus. C'est sans doute la stratégie à privilégier lorsque les ressources locales le permettent, ce qui doit être le souci des institutions et ne constitue pas celui des opérateurs privés. Quoique prévisible et réelle, cette importation peut être considérée comme marginale. Son impact est ainsi limité et difficilement mesurable. Néanmoins, la multiplication, la consolidation des points d'accès, le développement de services d'assistance de premier niveau devraient inéluctablement engendrer le développement d'un marché de diplômes à distance.
Bénin
L'importation de formation ou de contenus de formation a toujours été présentée comme un facteur de l'échec de certains projets de formation en Afrique. La meilleure forme de partenariat est celle qui est issue de la collaboration entre les experts du Nord et ceux du Sud.
Il est fondamental de ne pas oublier que ce sont les étudiants qui sont au centre de l'affaire. Il ne suffit pas de le dire, il faut que ce soit effectif. Les meilleurs projets pensés dans des bureaux à Paris, Washington, Bruxelles ou ailleurs, échouent si les étudiants ne sont pas concernés. Il ne suffit pas de les consulter, on doit considérer l'étudiant comme étant le partenaire principal. La prise en considération des besoins adaptés au contexte local est indispensable pour ne pas réitérer les erreurs du passé . Il y a une évidence, les spécialistes occidentaux ne pourront jamais savoir exactement les problèmes que rencontrent les récepteurs du Sud. Les projets de formation doivent donc être élaborés en étroite collaboration avec les spécialistes locaux. Des objectifs communs, le consensus sur les stratégies à mettre en œuvre, la coordination et les relations de travail doivent être établies avec les groupes techniques de travail.
Une véritable appropriation des contenus de formation n'est possible que si ces derniers correspondent au niveau de langages des étudiants, à leur milieu culturel et environnemental. Ce qui nécessite un effort d'adaptation des contenus conformes aux programmes officiels. En associant les enseignants du Sud dans l'élaboration des contenus de formation, ils se sentiront concernés, et impliqués dans la définition du projet. Pour cela il faudrait au préalable les sensibiliser, informer, instituer des formations pour les formateurs, puis pour les enseignants qui seront appelés à encadrer les télécours, à concevoir et réaliser des cours à distance.
Gabon
L'importation de formation a le mérite de proposer très rapidement une formation opérationnelle au niveau local et de sensibiliser les universitaires à la FOAD. Ces formations pourraient à mon avis avoir une influence négative sur la posture des universitaires, ils deviennent passifs car entrer en concurrence avec les FOAD développées au Nord avec les moyens du Sud est très difficile. Cependant l'importation de contenus pour les adapter et construire un cursus de formation complété avec du contenu endogène me semble être une piste intéressante pour les raisons suivantes :
Sénégal
Il faut privilégier la co-diplômation et la mise en commun des savoirs et donc des contenus des modules de formation. Il faut surtout éviter de transformer les universités du sud en nouveaux marchés de consommation de programmes de formations « prêt-à-porter ». Il faut reconnaître que la préférence pour les diplômes des universités du nord est grande chez les étudiants du sud.
Togo
Comment donner une cohérence à l'ensemble des initiatives ?
Produire et diffuser de l'information et des ressources de formation portant sur la gestion de salle informatique contribuerait à guider les responsables d'établissements dans la mise en place de structures
Bénin .
Devant la multiplicité des initiatives, une vision globale et une coordination de toutes les actions s'imposent. Il sera donc important de définir des stratégies locales fondées sur des objectifs de développement, acquérir l'expertise indispensable à la maîtrise des nouvelles technologies, définir un cadre législatif et réglementaire approprié. En somme, il faudra chercher à étudier et répondre aux besoins réels des pays récepteurs, afin d'intégrer le projet dans une planification à long terme. Il est de la responsabilité des organisations internationales et des agences de coopération d'aider ces pays à y faire face.
Gabon
Un premier élément manquant en général dans les pays est une structure TICE charger d'assurer une cohérence des actions avec des antennes au niveau décentralisé. Nous avons proposé au Sénégal la mise en place d'un réseau de centres de ressources multimédias régionaux qui devraient assurer ce rôle. Qu'en au problème de maintenance et de renouvellement du matériel, il devrait être pris en charge par le projet d'établissement (qui doit intégrer les aspect TIC).
Sénégal
Il y a un besoin de créer au niveau national un organisme de régulation et de contrôle des actions à entreprendre. Cette instance ne doit pas se mettre dans une position régressive par rapport au progrès technologique. Le risque sera de freiner le mouvement d’ouverture au TICE.
Togo
Peut-on considérer que la formation des enseignants justifie la création d'un centre de ressources multimédia dans chaque établissement ?
La création d'un centre de ressources multimédia au niveau décentralisé, au niveau d'un établissement, doit s'inscrire dans une politique nationale, concrétisée par un schéma directeur intégrant aménagement, équipement, développement de ressources humaines aux compétences et charges définies, intégration des activités dans les curricula et les plannings hebdomadaires enseignants/élèves.
Bénin
Dans la mesure des possibilités de chaque pays, les CDI présents dans les institutions de formations des enseignants doivent céder la place au centre de ressources multimédia (CRM). La formation des enseignants, à l'heure des TIC ne peut plus se concevoir sans la présence d'un centre de ressources multimédia comportant au moins des espaces informatiques : Logiciels, CD Rom, accès Internet... et une bibliothèque : documentation pédagogique, littérature. On n'y vient plus seulement pour lire et pour emprunter des volumes mais pour développer des méthodes de travail et des habiletés d'information.
Gabon
En Guinée Equatoriale, la formation des enseignants justifierait la création d'un centre de ressource au moins dans les établissements de formation des enseignants. Ici cette initiative pourrait s'élargir au niveau des lycées vu la petite taille du pays.
Guinée Equatoriale
Les centres de ressources au Sénégal sont localisés au niveau des Pôles régionaux mais ne sont autonomes. La Coordination de ces centres est indépendant de la Coordination Nationale de la formation Continuées. Les actions des centres de ressources concernent à la fois les enseignants et les administratifs mais un lien fort est établi avec la formation continue des enseignants. D'après notre expérience, les besoins en formation au ou par les TIC des enseignants et des administratifs (de l'éducation) justifient la mise en place d'un centre de ressource au niveau de chaque capitale régionale et un centre national assurant la coordination et la cohérence du dispositIf. D'autres problématiques obligent à une prudence dans le cadre du déploiement d'un tel dispositif. Nous pouvons noter :
Les écoles de formation d'enseignant aussi doivent disposer de centres de ressources, correspondants à une évolution du dispositif de documentation existant (bibliothèque ou CDI). Le risque ici est de mettre en place un dispositif indépendant, cela ne facilitera pas la convergence entre les formes de documentation.
Sénégal
Un centre de ressource ? pourquoi pas. La condition est de le rendre accessible et d’en assurer une bonne gestion./ Togo
Niveau scolaire et Universitaire
(à rédiger)
Formation des enseignants
(à rédiger)
Enseignement supérieur
(texte provisoire)
L’enseignement à distance ne vient donc pas « au secours des universités défaillantes »2 : il n’est dans l’état actuel des choses qu’une solution ponctuelle et très partielle, avec en outre des taux d’abandon spectaculaires (un étudiant sur deux en moyenne), et surtout un positionnement variable au sein de la complexité africaine relative au système de bourses en vigueur dans l’enseignement supérieur
Une observation de l’évolution du statut économique des étudiants serait aussi nécessaire. Dans de nombreux pays africains anglophones, le partage des coûts des programmes d’enseignement à distance existe entre les étudiants et la puissance publique. Au vu des limitations actuelles affectant l’utilisation des fonds publics pour le financement de l’expansion de l’enseignement supérieur, cet état de fait ne peut être remis en cause, et sera sans doute étendu dans les pays francophones, même si les dangers de «marchandisation» existent…
Pour les gros effectifs, en formation initiale, le pari envisagé sur l’enseignement à distance est hasardeux, sauf s’il se donne comme objectif de s’inscrire dans une politique volontariste de décentralisation des capitales politiques, souvent hypertrophiées, vers les provinces. Mais il s’agira alors avant tout d’une action volontariste d’aménagement des territoires des états d’Afrique de l’ouest La conception de formationstouchant des apprenants en nombre limités, souvent insérés dans un projet professionnel ou motivés par une entrée rapide dans la vie active. Ces formations reposent moins sur des disciplines universitaires, et davantage sur des sujets trans‑sectoriels ou trans‑disciplinaires, insérés dans le marché local de l’emploi.Dans l’enseignement supérieur, la mise à disposition, en ligne, de ressources maîtrisées scientifiquement et juridiquement devrait aussi suggérer une réflexion et des recherches sur le contrôle de la propriété intellectuelle en ligne mais au delà, sur le rôle et le mode de fonctionnement des établissements traditionnels de formation. Ceux-ci sont bien placés sans doute, car détenteurs, dans toutes les disciplines académiques et particulièrement dans le domaine de la formation des enseignants et des formateurs, des acquis de leur longues pratiques. Mais qui pour offrir une RESISTANCE CREDIBLE elles ne devraient pas craindre de s’interroger sur de nouvelles régulations.
Des procédures d'habilitation et d'évaluation fiables sont nécessaires pour persuader le public que les cours, les programmes et les diplômes proposés par les nouveaux types d'établissements d'enseignement à distance respectent des normes académiques et professionnelles acceptables. Il est probable que l'on mette moins l'accent sur des aspects traditionnels, tels que les qualifications du corps enseignant et les critères de sélection des étudiants, mais plus sur les compétences et les aptitudes des diplômés,
Deuxièmement, très peu de pays en développement ont mis en place des systèmes d'accréditation et d'évaluation ou ont accès aux informations nécessaires sur la qualité des programmes étrangers ou la capacité institutionnelle de contrôle permettant de détecter la fraude et de protéger les étudiants par rapport aux offres de qualité médiocre. Une étude réalisée récemment en Inde a montré que sur 144 institutions étrangères proposant, dans les journaux, des programmes d'enseignement supérieur, 46 n'étaient ni reconnues, ni habilitées dans leurs pays d'origine (Powar et Bhalla 2001). Les étudiants des pays à faible revenu courent un réel risque d'être les victimes d'opérateurs transfrontaliers sans scrupules.
(à rédiger)
Le travail collaboratif inter-pays en réseau,
La temporalité des actions : alternance présence/distance et la programmation par l’établissement et la tenue de calendriers de formation,
la mise à disposition de salles de ressources multimédia au sein des universités ou des organismes de formation professionnels
1 : P. Flichy, « Utopies et innovations, le cas Internet », Sciences Humaines N°16, mars 1997.
2 : Comme le prétend le titre de l’article « L’enseignement à distance au secours des universités défaillantes », Afrique Education N°68, avril 2000.