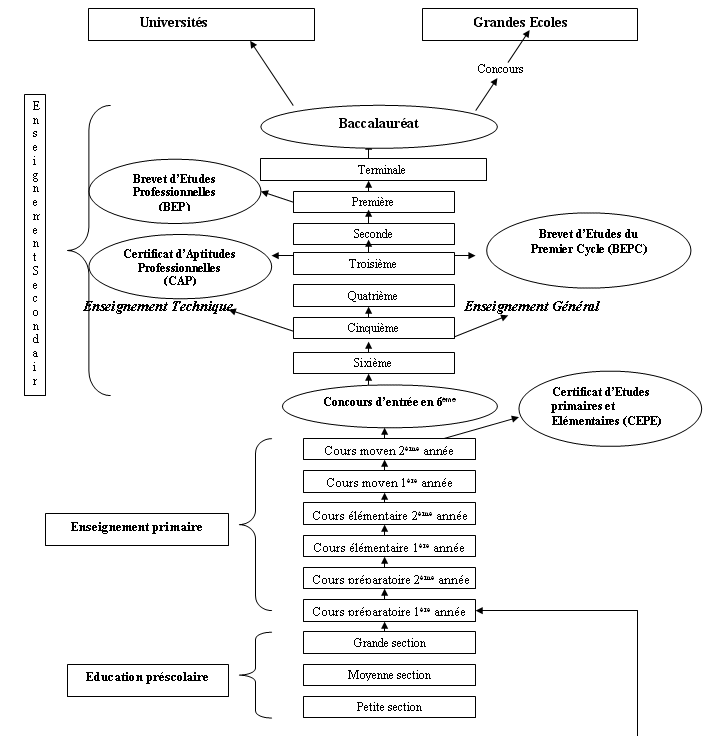ET DES DOCUMENTS DE COMMUNICATION DANS L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE
ET L’APPRENTISSAGE LIBRE,
(plus particulièrement pour la formation continue des enseignants)
Cas du Gabon
Brève présentation du pays
Pays d'Afrique Centrale situé sur la côte occidentale du continent, plus précisément dans le golfe de Guinée (le pays bénéficie d'une façade maritime de 750 km), le Gabon est traversé par l’équateur et limité au Nord-ouest par la Guinée Equatoriale, au Nord par le Cameroun, à l’Est et au Sud par le Congo. Avec une superficie de 267.667 Km2 et une population estimée à environ 1321600[1] le pays est constitué d’une population jeune, 39% de la population y est âgée de moins de 15 ans, l’espérance de vie y est de 52,4 ans et on y trouve 0,46 médecins pour 1000 habitants[2]. Le pays est constitué à plus de 75% par le bassin fluvial du fleuve Ogooué et recouvert sur près de 85% de son territoire par la grande forêt équatoriale on l’on trouve de grands arbres comme l’acajou, l’okoumé (fabrication des contre-plaqués).
Longtemps considéré comme l’un des pays les plus riches d’Afrique subsaharienne, le pays a connu un accroissement formidable de son P.I.B grâce à l’exploitation du pétrole, du manganèse, de l’uranium, du bois et une bonne conjoncture internationale qui lui ont permis de voir son PIB passer rapidement de 31,6 milliards de francs CFA en 1960 à 371,7 milliards de francs CFA en 1974. En l’espace de 11 ans (de 1974 à 1985), ce PIB a été multiplié par quatre (4) atteignant 1645,8 milliards en 1985. Cette forte expansion financière permit d’attirer les travailleurs et les capitaux étrangers d’Afrique, d’Europe d’Amérique et d’Asie, de distribuer des revenus élevés au regard des critères africains, de créer de multiples entreprises publiques subventionnées grâce à la manne pétrolière. Aujourd’hui, en dépit de la baisse de son PNB par habitant (environ 3400 dollars à l’heure actuelle contre 4800 dollars en 1993), le Gabon reste classé parmi les pays à revenu intermédiaire.
En effet, l’épuisement progressif des ressources pétrolières et l’arrêt de l’exploitation de l’uranium expliquent en partie la récession que le Gabon connaît depuis quelques années. D’autres difficultés socio-économiques fortement marquées par la dévaluation du franc CFA intervenue en 1994 et les fluctuations des prix des matières premières sur le marché international sont également la cause de ces difficultés qui aujourd’hui, se manifestent entre autres par l’exacerbation du chômage qui touche une partie importante de la population jeune. Cependant, le pays amorce un timide redécollage depuis 1995 avec la relative stabilisation des effets de la dévaluation, la diminution du taux d'inflation (de 30 % actuellement) et la mise en œuvre d'un programme triennal d'ajustement structurel. Les éléments clé du programme d'ajustement négocié avec le FMI concernent l’Assainissement des finances publiques, la Restructuration du secteur public, l’Amélioration des perspectives de croissance de l'économie non pétrolière. Quelques initiatives ont été prises afin d'endiguer le chômage : la mise en place d'un fonds spécialisé (le FODEX) destiné à favoriser l'émergence de petites et moyennes entreprises et la création de l'Office National de l'Emploi (ONE) et d’un Fonds d’Insertion.
I - Cadre sociétal et technique
A l’instar de tous les pays arrimés à l’économie mondiale, le Gabon vit au rythme des mutations et des phénomènes de la mondialisation et notamment des évolutions des technologies de l’information et de la communication. Selon l’UIT (Union internationale des télécommunications), le Gabon occupe aujourd’hui la première place en Afrique centrale et la septième sur le continent quant à l’indice de pénétration numérique[3] même si Annie Cheneau-Loquay émet quelques nuances sur cette assertion quand elle écrit : « il existe une forte distorsion entre villes et campagnes puisque toutes les lignes sont en ville et que Libreville à elle seule avec 27% de la population regroupe 72% des lignes soit 85 lignes pour 1000 habitants tandis que le reste du pays n’en compte que 12…le réseau téléphonique est peu développé et mal réparti sur le territoire national. Les lignes téléphoniques sont largement insuffisantes tant pour les particuliers que pour les administrations …le réseau téléphonique classique gabonais a un service de qualité médiocre et des coûts élevés »[4]. Quand on sait qu’au Gabon, une infime partie des demandes est satisfaite tandis que la plupart sont en instance (on enregistre des fois des attentes allant jusqu’à 2 mois voire plus), on ne peut pas manquer de s’interroger sur la fiabilité de la qualité du réseau. Cette situation explique le nombre élevé d’abonnés au téléphone cellulaire.
En effet, d’importantes mutations liées à l’évolution des technologies et à la libération progressive du marché ont été marquées depuis les cinq dernières années par le développement rapide depuis 1999-2000 de trois opérateurs de téléphonie mobile : Libertis (filiale de Gabon Télécom), Telecel Gabon (filiale de Atlantique Télécom) et Celtel Gabon (filiale de MSI Cellular). Les Gabonais adhèrent très facilement à ce mode de communication car il est souvent beaucoup plus facile d’obtenir une ligne de téléphone cellulaire qu’une ligne de téléphone fixe, même si les coûts sont beaucoup plus élevés. En effet, le prix des téléphones cellulaires varie énormément, le prix minimum se situant autour de 50 000 FCFA. Une fois le téléphone cellulaire en main, on doit s’abonner chez un fournisseur en s’acquitant d’une somme allant de 10000 à 15000 FCFA. Ensuite, il suffit d’acheter des cartes téléphoniques prépayées. Les frais reliés aux appels locaux sont sensiblement les mêmes chez tous les fournisseurs, soit de 250 FCFA la minute (aucun frais chargé pour la réception des appels).
Selon une enquête que nous avons menée auprès des trois opérateurs au courant du mois de septembre 2004, (Libertis, Telecel et Celtel) se partagent un marché d’environ 400.000 abonnés, dont 352000 ″abonnés actifs˝ Le taux de pénétration est ainsi estimé à 30% alors que la moyenne dans les pays africains se situe entre 10 et 15%, taux confirmé par l’I.U.T. D’ici la fin de l’année 2004, compte tenu de travaux d’extension de réseau en cours ou à venir, plus de 85% du territoire devrait être couvert. L’estimation la plus fréquente du marché potentiel est de 550000 abonnés ; le marché devrait arriver à maturité en 2006, et, dans cette perspective, la concurrence se durcit progressivement, avec des baisses de prix et le développement des services offerts par chaque réseau. Mais, malgré cette nouvelle concurrence, le réseau téléphonique n’est pas présent dans toutes les villes. En s’éloignant à peine des grandes villes, il y a de fortes chances que le téléphone cellulaire ne capte plus de signaux.
La mise en service de Gabon Télécom S. A., suite à la réorganisation de l’ex Office des Postes et Télécommunication (OPT), a été effective en avril 2002. Société anonyme créée conjointement par l’Etat et par d’autres actionnaires, personnes physiques ou morales de droit public ou privé, Gabon Télécom gère et exploite les services publics des télécommunications à l’intérieur comme à l’international. Elle assure en particulier l’accès au service du téléphone aux usagers qui en font la demande et établit des réseaux qui distribuent par câble des services de radio diffusion sonore ou de télévision. Dans le cadre du développement de son réseau de télécommunications, Gabon Télécom S.A. a participé à la construction d’un consortium avec quarante-trois autres pays opérateurs internationaux, par la signature d’un accord de construction, de maintenance et de réalisation d’un câble sous-marin à fibres optiques reliant de manière directe l’Europe, l’Afrique, l’Océan Indien et l’Asie, dénommé SAT-3/WASC/SAFE. Sa mise en service au Gabon a eu lieu le 31 juillet 2002. Ce nouveau support a permis au Gabon de s’affranchir de la dépendance exclusive du support satellitaire pour les communications internationales, d’accroître les échanges inter-Etats africains, de réduire substantiellement les tarifs eu égard au coût de maintenance du câble, et de disposer d’une voie d’intégration des TIC, de l’Internet, de transfert de données à haut débit. Le Gabon est ainsi désormais prêt à disposer des services nouveaux tels que la télémédecine et le télé-enseignement.
L’arrivée des nouvelles technologies de l’information et de communication est récente au Gabon. En effet, l’avènement du réseau Internet au Gabon intervient en mars 1997 avec l’installation par l’opérateur public national de l’époque OPT (aujourd’hui devenu Gabon Télécom) d’un nœud expérimental à Libreville de 128 kbs avec MCI (USA). La Commission Nationale de l'Informatique (CNI), directement rattachée à la Primature, est responsable du développement de l’Internet dans le pays. Depuis février 2000, date de la création de l’agence de régulation des télécommunications, les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) sont autorisés au Gabon. Ainsi, en plus de Gabon télécom, il y a quatre autres sociétés : Internet Gabon, Solsi, SITA, et le Campus numérique francophone. Mais, la mauvaise répartition du réseau téléphonique classique, au niveau national, et ses autres caractéristiques (mauvaise qualité, coûts élevés…) ne permettent pas un accès optimum à Internet. Avec le câble sous-marin à fibres optiques, les connexions ont été améliorées, les cybercafés se sont multipliés et beaucoup de Gabonais s’intéressent de plus en plus aux TIC. Un tour dans les cybercafés de plus en plus nombreux dans la capitale Libreville nous a révélé que les internautes gabonais sont diversifiés. Même si la majorité d’entre eux est occupée par une population jeune d’environ 14 à 30 ans, les jeunes enfants et les adultes un peu plus âgés se connectent également de plus en plus. Notre enquête sur les usages d’Internet a révélé qu’ils sont également de plus en plus diversifiés, 90 % des internautes gabonais utilisent cette nouvelle voie de communication pour entrer en contact avec des gens de partout à travers le monde, via le courrier électronique et le chat, 6% sont des étudiants qui utilisent Internet pour élargir leur recherche et avoir accès à de l’information qu’ils ne pourraient trouver dans les bibliothèques gabonaises, seulement 4 % cherchent des rencontres à travers Internet. Les coûts sont généralement les mêmes dans tous les cybercafés, soit de 1000 CFA/heure. Le nombre d’ordinateurs varie considérablement, allant de deux ou trois postes jusqu’à plus d’une vingtaine. Enfin, les gens qui désirent fréquenter les cybercafés ne nécessitent pas de connaissances particulières. Il y a, dans chaque cybercafé, des moniteurs qui sauront aider et former sur place les usagers désirant aller sur le net. (N’ayant pas eu les tarifs sur l’accès à Internet par une ligne téléphonique auprès du Directeur commercial du service Internet, nous nous fions aux estimations d’un article paru sur Internet[5] en 2000 les tarifs étant restés inchangés jusqu’alors). Les principaux forfaits répertoriés en francs CFA sont :
Tableau 1 : Les forfaits d’abonnements Internet
Abonnement mensuel |
Nombre d’heures d’usages par mois |
Gabon Télécom |
Internet Gabon |
5 heures |
10 000 |
7 200 |
|
10 heures |
15 000 |
13 500 |
|
30 heures |
35 000 |
36 450 |
En ce qui concerne la communication, elle reste placée sous l’autorité du Ministère de la Communication et des Technologies de l’information. Depuis 1992, le conseil National de la Communication, organe constitutionnel à caractère consultatif, fait office d’autorité morale. L’Agence gabonaise de Presse est chargée de la collecte et de la diffusion de l’information. La presse écrite locale s’exprime en français. L’Union est le premier quotidien gabonais. Depuis 1990 (date de la tenue de la Conférence Nationale), un certain nombre d’hebdomadaires publiés par les partis de l’Opposition ont vu le jour (la parution de la plupart de ces journaux a été interdite, c’est le cas de Misamu, la Griffe…
Le Gabon dispose de deux chaînes de radiodiffusion, couplées avec la télévision nationale, d’une radio à vocation internationale, Africa N° 1, et de diverses radios FM commerciales ou associatives (Black FM, Mandarine, Top FM, Radio Emergence, Radio Sainte Marie, etc.). Deux chaînes de télévision publique (RTG1&RTG2), quatre chaînes de télévision privées (Télé-Africa, TV+, RTN, Chaîne 5) et des chaînes internationales (Canal Horizon, TV5, CNN, Euronews, etc.) viennent compléter le paysage audiovisuel gabonais. Comme la plupart des pays de la sous-région le Gabon, utilise le système Secam K’. Cependant, il a continuellement fait des efforts pour améliorer la qualité de la radiocommunication. L’article de Mikeni Dienguiesse[6] paru dans l’Union nous révèle que depuis la tenue à Genève en Suisse (du 10 au 28 mai 2004) de la première session régionale des radiocommunications initiée par l’Union internationale des télécommunications (UIT), le Gabon envisage le passage en Pal B en VHF (très haute fréquence) et en Pal G en UHF (ultra-haute fréquence).Ceci pour tenir compte des évolutions technologiques du moment, notamment la numérisation, aux fins d’élaborer des plans analogiques (VHF et UHF) dans le cadre des assignations existantes ou en projet. Ce qui conduira automatiquement à l’abandon définitif du système Secam K’ encore en vigueur.
Tableau 2 : Situation des télécommunications au Gabon :
Quelques statistiques |
|
Nombre de lignes téléphoniques |
33.000 |
Nombre d’abonnés au téléphone cellulaire |
400.000 |
Nombre d’abonnés au télex |
250 |
Coût d’abonnement téléphonique |
54.450 F CFA |
Coût d’appel inter provincial /mn Coût d’appel local/mn Coût d’appel d’un poste fixe vers un mobile GSM/mn Coût d’appel en international/mn |
90 F CFA 50 F CFA 250 F CFA 6000 F CFA |
Nombre de fax / Télex |
250 |
Densité téléphonique |
3,60 |
Données recueillies auprès de M. Frédéric Bouckat et de M. Manana respectivement Responsable du service téléphonique et Directeur commercial du service Internet à l’Agence de recouvrement de Libreville
Tableau 3 : Situation prévisionnelle des grands médias
2006 |
2009 |
|
Radiotélévision |
VHF (très haute fréquence Pal G en UHF (ultra-haute fréquence). |
VHF (très haute fréquence Pal G en UHF (ultra-haute fréquence). |
Lignes téléphoniques Téléphone Cellulaire |
Raccordement de toutes les villes moyennes du pays Couverture nationale 85% |
Téléphonie en zone rurale Couverture nationale 100% |
Internet |
Réduction des prix grâce au câble sous-marin à fibre optique |
Accès dans toutes les villes moyennes du pays |
II Organisation de la formation des enseignants
2.1 - La formation initiale
La formation initiale des enseignants du primaire s’effectue dans des Ecoles Normales des Instituteurs (ENI). Le pays compte 4 ENI chargées de la formation des instituteurs, le recrutement se fait par concours après l’obtention du baccalauréat. Les instituteurs du secteur public sont formés aux ENI de Libreville et de Franceville. Alors que ceux du secteur privé catholique et protestant sont formés respectivement à l’ENIC (école normale des instituteurs catholiques) et à l’ENIP (école normale des instituteurs protestants) de Libreville. Il est prévu (dans deux ans) si l’on s’en tient aux déclarations du Directeur adjoint du service de la Planification, la création de deux autres écoles normales des instituteurs à Oyem et Mouila. Les enseignants sont dans leur grande majorité ceux des lycées et collèges pour des disciplines d’enseignement général (Français Mathématiques, Histoire…), la pédagogie est enseignée par des inspecteurs et autres conseillers pédagogiques.
Au niveau du secondaire, les professeurs sont formés dans deux établissements de formation des enseignants : l’Ecole Normale Supérieure (ENS) pour les enseignants du second degré général et l’Ecole Normale Supérieure de l’enseignement technique pour les enseignants du second degré technique.
2.2 - La formation continue
Le système éducatif connaît de sérieux dysfonctionnements depuis une dizaine d’années. Le résultat est patent au niveau du faible rendement des élèves. Parmi les écueils, figurent en bonne place le manque de structures d’accueil, le suivi des enseignants, la pléthore d’effectifs, etc. Afin de remédier à certains de ces maux, le ministère de l’Education nationale a entrepris plusieurs initiatives, dont la mise sur pied des centres de perfectionnement pédagogique dans trois localités du pays : Libreville, Mouila et Oyem. Ce sont des lieux d’échange, de mise à jour et de perfectionnement permanent, fréquentés par des groupes de 10 à 15 enseignants provenant de localités voisines.
Sur le plan organisationnel et fonctionnel, chaque centre a un directeur qui a la charge de sa structure. IL est assisté de deux formateurs, l’un s’occupant du premier degré et l’autre du second degré. La planification et l’organisation de la formation sont assurées par les responsables de l’établissement. Le ministère de tutelle, à travers l’Institut pédagogique national, y envoie des thèmes variés qui sont traités par le corps pédagogique. Au titre de l’année scolaire 2003-2004 par exemple, plusieurs sujets ont été abordés, tels « enseigner la lecture au CP1 », enseigner les sciences autrement », « les parents et les élèves », etc.
Selon les estimations des responsables du ministère de l’Education nationale, dès la rentrée scolaire 2004-2005, une troisième composante verra le jour. Elle sera chargée de la formation des proviseurs des lycées, des directeurs de collèges et d’écoles primaires. Une façon sans doute, comme l’a souligné l’inspecteur joseph Ndangoula, « de professionnaliser le poste de chef d’établissement scolaire »
Les textes organiques prévoient également l’implication de l’ENS dans la formation continue des personnels de l’Education nationale. Aussi, existe-t-il à l’ENS un Département des Stages et de la formation continue. En effet, en vue de la préparation des candidats aux concours de recrutement des élèves conseillers pédagogiques et élèves inspecteurs du premier degré, L’ENS a mis en place de 2001 à 2003 des cours du soir pour les enseignants du primaire résidants à Libreville. Toutefois, le manque d’équipements des nouvelles salles de classe et le prolongement de la durée des cours au-delà de vingt heures (20) n’ont pas permis de prolonger cette initiative. C’est au cours de l’année 2004 que le Département des stages et de la formation continue s’est associé à la section de la formation à distance déjà existante à l’ENS depuis quelques années, cette section était chargée jusque là de la formation à distance des professeurs de français. Ce projet, interrompu depuis près de quatre ans, était piloté par l’Agence Intergouvernemental de la Francophonie (AIF).
Le Département envisage poursuivre les objectifs suivants :
- préparation aux différents concours d’entrée à l’ENS
- perfectionnement en langues et en techniques de laboratoire dans les matières scientifiques
- culture générale
- formation des formateurs aux TIC
- formation des professeurs des établissements privés reconnus d’utilité publique (délivrance d’une habilitation à enseigner dans le système éducatif gabonais).
III – Situation actuelle dans l’enseignement secondaire et primaire
Depuis un certain nombre d’années, l’échec scolaire prend des proportions inquiétantes dans le système éducatif gabonais. Cet échec se caractérise par les redoublements, les abandons, les retards et la non maîtrise des compétences et ce, malgré l’importance des moyens alloués à l’action éducative. Le pourcentage des enfants ne terminant pas leur scolarité, est estimé à 41%, résultats des grands problèmes que connaît le système éducatif gabonais. En effet, dans le secondaire général, l’analyse de la situation actuelle fait apparaître un déséquilibre et un dysfonctionnement profonds, portant atteinte à l’efficacité interne et externe du système éducatif. Une étude menée en avril 2001 par le Ministère gabonais de l’Education Nationale a révélé que dans le primaire, en dépit d’un fort taux d’accès à l’école avoisinant les 100%, le pays connaît un taux de survie scolaire les plus faibles d’Afrique Noire, de même que le taux de redoublement constitue une réelle préoccupation. Selon le rapport de l’Institut de Recherche sur l’Économie de l’Éducation[7], outre une faible rétention, le Gabon est l’un des pays du monde où les redoublements de classe dans le primaire (mais aussi dans le secondaire) sont les plus fréquents. Selon le même rapport, le taux moyen de redoublement dans l’enseignement primaire au Gabon serait de l’ordre de 40%, alors que les chiffres sont respectivement de 7 et de 24% pour la moyenne des pays africains francophones et anglophones (et qu’il existe en fait très peu de pays dans le monde où le taux de redoublement dans le primaire est aussi élevé que celui observé au Gabon). D’après ce rapport, on compte qu’environ 55% des enfants qui accèdent à la première année du primaire réussissent à atteindre la dernière année du cycle, alors qu’on considère que les enfants qui ont eu un abandon en cours de scolarité primaire ont une probabilité forte d’être ultérieurement des adultes analphabètes. Parmi les causes d’abandon scolaire, nous pouvons citer entres autres, le concours très sélectif d’entrée en 6ème (seulement 9000 élèves admis sur 30.000 inscrits en 1998, soit un échec de 70%), les effectifs pléthoriques dans les classes, etc.
Tableau 4 : Quelques chiffres sur les taux d’abandon et de redoublement dans le système éducatif gabonais (2001)
Taux de redoublement |
|
Primaire |
40% |
Secondaire |
24,6% |
Taux d’abandon |
|
Primaire |
17% |
Secondaire |
Source : L'évaluation de l'éducation pour tous à l'an 2000 : Rapport des pays.
Tableau 5 : Le développement humain au Gabon
Quelques chiffres |
|
Taux d'alphabétisation |
66,2 |
Taux net de scolarisation - primaire |
94,84 |
Taux net de scolarisation - secondaire |
16,5 |
% d'enfants ne terminant pas l'école primaire |
41 |
Indicateur du développement humain |
0,607 |
PNB par habitant ($) |
4.120 |
Dépenses publiques affectées à l'éducation en % du PNB: |
2,8 |
Source : Rapport mondial sur le développement humain 1999, Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).
Selon le rapport mondial sur le développement humain du PNUD, le taux d’alphabétisation au Gabon est estimé à 66,2. Ceci s’explique par les efforts que l’État gabonais déploie dans le domaine de l’alphabétisation grâce aux programmes mis en place et appuyés par des ONG et le ministère de la Culture et du Bien-être social. En effet, le gouvernement gabonais a mis en place une politique et un programme d’alphabétisation avec le concours des partenaires (l’UNESCO, l’UNICEF, la WWF). L’objectif visé est de faire acquérir aux gabonais les notions et l’apprentissage de l’hygiène, de la gestion des activités de civisme.
Il est important de signaler les progrès très importants réalisés par le système éducatif gabonais au cours des trois dernières décennies. Aujourd’hui, les taux bruts de scolarisation du primaire sont parmi les plus élevés de l’Afrique francophone. Le taux brut de scolarisation est passé de 142,4% en 1992/93 à 149,5% en 1996/97. Ce niveau élevé du taux brut de scolarisation s’explique, entre autres, par la présence de beaucoup d’élèves ayant un âge plus ou moins élevé par rapport aux groupes d’âge officiellement scolarisable. Selon le tableau 3, le taux net de scolarisation est également élevé au Gabon, il est estimé à 94,84%. Cette assertion est confirmée par le rapport national sur l’évaluation de l’Education pour Tous, Bilan à l’an 2000 qui précise que le taux net de scolarisation primaire avoisine les 100% au Gabon.
3.1 - Politiques nationales d’équipement et de connexion
En 2001, le gouvernement gabonais avait offert à tous les lycées du pays un parc informatique de 500 ordinateurs (15 ordinateurs par lycée) pour l'initiation des élèves à l’informatique et la connexion au réseau Internet. Une promesse d’équipement des collèges d'enseignement secondaire avait été également faite pour la rentrée 2002 par le Ministre de l’Éducation nationale qui, à en croire ses propos, l'opération devait s'étendre davantage car, déclarait-il : « une fois que ces structures seront outillées, nous allons nous appuyer sur elles pour vulgariser l'informatique au niveau des établissements primaires. On pourra par exemple concevoir des grappes autour de chaque établissement secondaire rayonnant sur un certain nombre d'écoles de sa circonscription[8] ». La mise en place de cette initiative, devait également s'accompagner de la formation, dans chaque établissement de 5 enseignants pour l'initiation des élèves. Un article paru dans le journal " l'Union "[9] signalait également qu'en même temps, à l'Institut Pédagogique National, un centre de formation pour les enseignants qui le désireront devait être créé. Mais malheureusement, le départ du Ministre mit fin à cette initiative, le projet fut abandonné et la connexion à Internet des lycées n’avait jamais vu le jour. Aujourd’hui, les quelques machines présentes dans les lycées sont presque inutilisables le cours d’informatique ne figurant pas dans le programme scolaire, les quelques rares élèves qui s’y intéressent s’abonnent aux clubs privés ou fréquentent les cybercafés. Déjà, l’enquête que nous avons menée en 2002[10] dans un des lycées "vitrine" du territoire scolaire gabonais, le lycée National Léon MBA de Libreville, avait révélé que les ordinateurs offerts par le gouvernement n’avaient jamais été utilisés à cause de leur nombre insignifiant par rapport au nombre d’élèves. En effet, avec un effectif de 5400 élèves dans ledit lycée en 2002, la densité d’élèves par ordinateur était de l’ordre de 360 élèves par machine.
3.2 - Structure générale du système éducatif gabonais
Dans le système éducatif gabonais, on distingue trois types d’éducation :
- l’éducation formelle qui concerne l’ensemble des connaissances acquises dans le cadre scolaire ;
- l’éducation non formelle qui regroupe toutes les formes de formation organisée dans le cadre extra-scolaire (formation professionnelle, alphabétisation…) ;
- l’éducation informelle qui est l’ensemble des connaissances acquises par l’expérience de la vie quotidienne.
Le système éducatif gabonais est structuré en 3 grands cycles (voir annexe 3) :
- le cycle primaire composé de l’enseignement préscolaire qui accueille les enfants de 3 à 5 ans (il dure 3ans) et de l’enseignement primaire qui reçoit les enfants de 7 à 12 ans (il dure 6 ans). L’enseignement préscolaire n’est pas obligatoire et coûte encore cher, car dispensé la plupart du temps dans des écoles maternelles privées, (seuls quelques enfants passent par ce cycle). Au terme de leur scolarisation préscolaire, ces élèves ont l’avantage d’entrer directement au cours préparatoire 1ère année (CP1). L’enseignement primaire est sanctionné par le Certificat d’Etudes Primaires et le Concours d’entrée en 6ème donnant accès à l’enseignement secondaire.
- le cycle secondaire général et technique reçoit les enfants âgés de 6 à 12 ans. Les élèves sont admis dans l’enseignement secondaire sur la base de l’obtention du concours d’entrée en 6ème. Il est divisé en deux cycles : le premier cycle qui va de la 6ème en 3ème (il dure 4 ans) et second cycle qui va de la 2nde en Terminale (3 ans). Les 7 années dans l’enseignement secondaire sont sanctionnées par le baccalauréat, diplôme donnant lui-même accès à l’enseignement supérieur.
- le cycle supérieur. L’enseignement supérieur est dispensé dans deux universités : l'Université Omar Bongo Ondimba de Libreville (UOBO) et l'Université des Sciences et techniques de Masuku (USTM) de Franceville. Le Gabon compte également une dizaine d'écoles supérieures de formation professionnelle non universitaires publiques et privées.
3.3 – L’organisation du système éducatif
L’administration du système éducatif est organisée autour du Ministère de l’éducation nationale (MEN) et d’un Cabinet ministériel délégué. Au niveau régional, le MEN compte une Inspection Déléguée d’Académie (IDA) dans chacune des 9 régions et des chefs Secteurs départementaux de l’Education nationale. L’IDA est responsable de tous les niveaux d’enseignement pré-universitaires public et privé. Elle exerce son autorité sue les établissements d’éducation préscolaire, les écoles élémentaires, les collèges d’enseignement secondaire et les lycées, ainsi que les centres de formation pédagogique. En dehors de l’inspecteur délégué d’académie affecté pour l’administration de l’enseignement dans la province, on trouve également la présence d’un chef de service provincial chargé de la gestion de la carte scolaire. Chaque IDA dispose de deux ordinateurs (un portable et un fixe) d’une imprimante ainsi que d’une voiture de liaison offerte par l’Union Européenne (UE). En dehors du MEN, d’autres départements ministériels ont un rôle d’éducation assez important. C’est le cas du Ministère de la culture et de certaines ONG chargés de l’alphabétisation.
Le Ministère de l’éducation nationale est aujourd’hui informatisé, chaque service est doté de matériel informatique. Cependant, seule la direction de l’enseignement technique est connectée à Internet, projet financé par la coopération canadienne dans le cadre de l’appui à la réforme de l’enseignement technique. Selon le responsable du service informatique de la DPPI (Direction de la programmation et de la planification), la connexion intranet du ministère est en projet. D’ailleurs c’est en prélude à ce projet que durant l’année scolaire 2003-2004, trois formations (donc deux financées par l’UE) ont été données aux personnels d’encadrement du ministère. La première avait pour objectif la mise à niveau des agents (l’initiation à l’informatique), la deuxième formation qui intervenait trois mois plus tard concernait le personnel d’encadrement, les responsables des établissements du secteur public et confessionnel ainsi que les responsables de la gestion de la carte scolaire affectés dans les Inspecteurs Délégués d’Académie (IDA), au total (13 agents). Une troisième formation applicative de la gestion de la carte scolaire de 13 chefs de services provinciaux devait intervenir un peu plus tard au courant de la même année.
Selon une dépêche parue sur Internet[11], les autorités gabonaises et le numéro un mondial du logiciel Microsoft ont signé à Libreville un contrat de 3 milliards de francs CFA (4,5 millions d’Euros) sur 3 ans pour la mise en place d’une "administration électronique" au Gabon. L’administration électronique ou e-gouvernement est l’utilisation des TIC dans le secteur de l’administration publique notamment par la mise en ligne des services administratifs et par l’interconnexion des différentes administrations. Un volet du contrat signé entre Microsoft et le Gabon prévoit entre autre un programme d’éducation destiné à renforcer les capacités des enseignants et des élèves en favorisant leur accès technologique de l’information et de la communication les plus récentes et leur donnant une formation adéquate.
3.4 - Les actions des bailleurs de fonds
Au Gabon, la part des dépenses publiques consacrées à l’éducation (tous niveaux confondus) n’est pas très élevée : en 2000, elle s’élevait à environ 20% hors service de la dette et à 5% si on prend en compte le service de la dette. L’État reste cependant le principal bailleur du système éducatif gabonais, la participation des collectivités locales est faible (villages, municipalités, cantons, préfectures). En vue de renforcer et développer les structures d'accueil, et remédier aux problèmes des effectifs pléthoriques, le budget de l'État bénéficie de temps en temps de la contribution importante des partenaires techniques et financiers, dans le cadre de la coopération bi et multilatérale par des financements extérieurs provenant des bailleurs de fonds tels que : la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Islamique de Développement (BID) ; l'Union Européenne (EU) et l'Agence Française de Développement (AFD). Il est important de signaler que, considéré comme le seul pays de l’Afrique subsaharienne à revenu intermédiaire, le Gabon ne bénéficie pas de financements concessionnels accordés par les institutions de Bretton Woods, la Banque Africaine de Développement (BAD) et d’autres bailleurs de fonds. Les cinq principaux types d’aide reçus par le Gabon sont : la coopération technique autonome, la coopération technique liée à des projets, l’aide aux projets d’investissement, l’appui budgétaire ou à la balance des paiements, l’assistance et les secours d’urgence. L’Aide Publique dont bénéficie le Gabon provient essentiellement de trois sources : les sources bilatérales, les sources multilatérales et les organisations Non Gouvernementales (ONG). A titre d’exemple, le Fonds européen pour le développement (FED) qui soutient l’éducation de base a construit 58 salles de classes primaires à travers le pays grâce aux fonds qu’il gère d’ailleurs lui-même. La Banque Africaine pour le développement (BAD) se charge du renforcement des capacités d’accueil dans l’enseignement technique et professionnel. De même, la Banque islamique de développement (BID) s’est chargée de la construction des salles de classes (171 salles de classes) à travers le pays et de 20 logements pour les Directeurs d’école. Elle s’est chargée également de la construction du lycée d’Etat avec internat de 1200 élèves à Franceville. Ce projet connaît aujourd’hui quelques problèmes de finalisation compte tenu des retards de paiement de la partie gabonaise. Dans le cadre de la coopération Gabon-USA, la mission Peace Corps met à la disposition de l’Etat gabonais du personnel chargé de construire des écoles dans l’intérieur du pays.
IV – Situation actuelle dans l’enseignement supérieur
L’étude d’Alain Mignot[12] nous donne un aperçu général de l’organisation de l’enseignement supérieur gabonais. En effet, l’enseignement post-baccalauréat est assuré au Gabon par deux types d’institutions : des établissements de formation professionnelle liés à des ministères techniques et ayant vocation à former aux métiers de l’administration à l’instar de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) ou l’enseignement primaire (Ecoles Normales des Instituteurs) et des établissements placés sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Technologique et ayant pour missions de former aux métiers de l’enseignement secondaire et d’organiser des formations sanctionnées par des diplômes attestant des compétences dans un secteur disciplinaire.
4.1 - L’organisation des études
Au Gabon, les études universitaires sont organisées en années académiques par un examen terminal et, pour les filières longues, structurées selon la formule DEUG (2 ans) Licence (1an) DEA ou DESS (1 an).
Selon Alain Mignot, l’offre de formation est assez complète mais l’enseignement de base manque encore de beaucoup de compétences, notamment dans les disciplines techniques et scientifiques. On y trouve, l’ensemble des grandes filières classiques débouchant en principe sur une maîtrise (Bac+4) ainsi que des filières techniques longues (5 ans) et des filières techniques courtes (3 ans). Celles–ci sont par ailleurs complétées par des préparations aux métiers de l’enseignement. Les filières techniques longues donnent accès au titre d’Ingénieur". Elles sont orientées vers trois secteurs : le génie civil, le génie électromécanique, et le génie agricole. Les formations techniques courtes donnent quant à eux accès au titre de "Technicien Supérieur". Elles sont orientées aussi bien vers le secteur secondaire que vers le secteur tertiaire. Concernant ce dernier secteur, figurent les 3 BTS (comptabilité-Gestion, action sociale, et commerce international) organisés par l’Institut National des Sciences de Gestion (INSG), les 3 diplômes universitaires de technologies (gestion des entreprises et des administrations, techniques de commercialisation, informatique) organisés par l’Institut des Sciences et Techniques (IST) et les formations en secrétariat organisées par L’ENSS.
Concernant le secteur secondaire, figurent outre une formation de sages-femmes et de techniciens supérieurs en biologie médicale à l’Université des Sciences de la Santé (USS), les filières de techniciens supérieurs en génie civil, en génie électromécanique et en génie agricole à l’Université des Sciences et techniques de Masuku (USTM). Enfin il faut ajouter bien que l’école dépende du ministère des eaux et forêts, le diplôme d’Ingénieurs des techniques des Eaux et forêts (techniciens supérieurs) auquel prépare l’Ecole Nationale des eaux et forêts (ENEF). Le recrutement dans tous les cas se fait par concours.
4.2 – Situation de la formation à distance (FAD) dans le système éducatif gabonais
D’après les responsables gabonais du département de l’éducation, le Gabon n’a pas de tradition en matière de formation à distance. En effet, mis à part quelques initiatives privées isolées et quelques projets récents, la plupart des projets en matière de FAD initiés au Gabon n’ont jamais vu le jour et, ceux qui ont démarré ont aussitôt effondré. C’est le cas en 1991, de l’"Ecole Francophone d’été" à laquelle prend part l’Institut Pédagogique National (IPN) du Gabon. Ce programme qui visait à la création ou au développement d’institutions nationales de formation à distance dans ces différents pays sera malheureusement arrêté en 1993 lorsque l’Agence cessa son financement. En 1996 l’AIF initia également un programme de formation des agents du système éducatif, plus particulièrement la formation des enseignants du secondaire en cours d’emploi dont le niveau académique dépassait la plupart du temps le baccalauréat et dont la formation professionnelle s’était faite le plus souvent « sur le tas »[14]. Mais, au cours du biennum 2000/2001, l’Agence décida de réorienter sa politique en abandonnant son implication dans la formation des enseignants et en supprimant les actions de terrain pour ne privilégier que les approches visant l’analyse, l’élaboration et l’appui aux plans nationaux de formation à distance.
Jusque là, les rares actions de FAD sont menées soit par l’IPN, le Campus Numérique Francophone ou par l’École Normale Supérieure de Libreville. En dehors de ce cadre, un certain nombre d’apprenants suivent à titre individuel les cursus en ligne dispensés par des centres de FAD européens ou américains. Pour des études académiques, c’est sans doute au Centre National d’Enseignement à distance (CNED) que l’on s’inscrit le plus volontiers. L’étude menée par le RESAFAD[15] révèle qu’au Gabon, pendant l’année académique 2001/2002, 143 étudiants s’y sont inscrits.
Dans le cadre de la coopération entre le Gabon et le Canada, l’Université Laval a mis en place à l’ENS, depuis 2000, un programme de Maîtrise en didactique des disciplines. Actuellement, 37 étudiants (enseignants permanents et vacataires de l’ENS et ceux du secondaire) sont inscrits à la faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval dans différentes disciplines. Les enseignements sont assurés par les professeurs de Laval, à raison de deux sessions par an. Entre les sessions, les étudiants restent en contact permanent avec leurs professeurs, grâce à Internet et effectuent des travaux qu’ils expédient en fichier joint à leurs enseignants.
Depuis 2000, l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) donne accès à des formations à distance s’appuyant sur les technologies réseau. La formation à distance qui intéresse le plus les professeurs du supérieur est le DESS UTICEF, devenu master en 2004[16]. Il a été mis en place depuis 2000 par un consortium d’universités européennes et africaines (Université Louis Pasteur de Strasbourg, Université de Mons, Université de Genève, Université Cheikh Anta Diop et l’Université de Tunis. Il vise à former des personnels de l’éducation de haut niveau sur l’intégration des TIC dans les dispositifs de formation. Au moins 2 enseignants gabonais ont déjà été formés via le Campus numérique francophone basé à l’Université Omar Bongo Ondimba de Libeville.
Conclusion
Il existe un large consensus pour reconnaître l’existence de graves carences dans la formation continue des enseignants gabonais. Avec la situation qui prévaut actuellement, on ne manque pas et on est en droit de croire que dans l’esprit des administrateurs éducatifs, les enseignants n’ont besoin que d’une formation initiale et qu’ils pourront acquérir par leurs efforts personnels de nouvelles connaissances et compétences. Or, les enseignants, en tant que professionnels, doivent être formés non seulement avant de remplir leurs fonctions dans une classe, mais également après avoir commencer à enseigner. La formation des enseignants doit être vue comme un processus unique en deux temps : initiale et continue. Prendre ces deux temps en compte n’implique pas cependant que les enseignants soient nécessairement formés dans des écoles normales. On pourrait chercher d’autres manières de donner une formation systématique et continue qui peut être dispensée en dehors des institutions formelles (écoles normales ou institutions de formation des enseignants).
La formation continue des enseignants doit être perçue comme une opportunité pour mieux se rendre compte du fait qu’ils sont des acteurs sociaux et des agents possibles du changement. Par cette formation, ils doivent acquérir des compétences qui leur permettraient de renforcer leurs performances et les y encourageraient. En effet, comme pour la formation initiale, la formation continue ne doit pas constituer un événement ponctuel de courte durée. Ce qui fait dire à Torres que « la formation n’est souvent dispensée que pour la mise en œuvre d’une politique ou d’un projet et n’a pas de caractère continu » (Torres, 1995)[17]. Elle pourrait prendre la forme d’ateliers périodiques et de production régulière de matériel éducatif. Ces ateliers doivent être fréquemment standardisés et présentés par des experts qui sont familiers des problèmes spécifiques aux différentes écoles. Par la suite, ils vont permettre aux praticiens de résoudre leurs difficultés quotidiennes. Il faut penser au rôle que peuvent jouer les syndicats et les organisations professionnelles des enseignants pour concevoir des ateliers.
L'enseignement à distance se présente comme un moyen de renforcer les opportunités d'éducation sur le pays. Le développement rapide des nouvelles technologies de l’information et de la communication ouvre des perspectives intéressantes pour les stratégies de l’enseignement à distance qui peut être utilisé pour promouvoir la formation des enseignants sur un pays où plus de 70% d'entre eux ont grand besoin d'être recyclés.
Les méthodes de formation à distance doivent être de plus en plus reconnues comme étant des outils valables pour élargir l'accès à l'enseignement supérieur tout en renforçant la pertinence et la qualité de l'éducation.
En ce qui concerne l’usage de ces TIC dans le système éducatif gabonais, nous avons constaté que si le Gabon se trouve aujourd'hui connecté au réseau mondial Internet, il n'en demeure pas moins évident que ce formidable outil reste encore largement sous-exploité partout à travers le pays. Aujourd’hui le problème n’est pas seulement d’être au diapason des nouvelles technologies mais aussi, de les utiliser pour améliorer la qualité globale du système éducatif, de la gestion administrative aux enseignements. L’introduction des TIC dans le système éducatif gabonais est une innovation non seulement technologique mais aussi pédagogique. Les principaux acteurs de l’intégration des TIC dans l’école étant les enseignants, il convient donc de susciter chez ces derniers un sentiment d’appropriation des TICE, cela passe par une formation de qualité qui soit mise à jour périodiquement. Il faut pour cela disposer de moyens qui se composent de plusieurs éléments :
- une équipe enseignante qui ait reçu une formation de base adaptée, lui permettant d’apprendre et d’appliquer de nouvelles compétences pédagogiques ;
- suffisamment de temps pour que les enseignants étudient après leur journée de travail pédagogique ;
- une structure nationale ou locale pour que les enseignants travaillant dans les zones les plus reculées puissent recevoir une formation continue.
- Enfin le Gabon pourrait adopter et généraliser l'apprentissage de l'informatique depuis l’enseignement secondaire ou si possible depuis l’enseignement primaire dans l'optique de mieux préparer les générations futures à l'usage dorénavant obligatoire des services qu'elle offre.
Les leaders des secteurs politiques et éducatifs au Gabon devront être de plus en plus conscients du potentiel de la formation à distance comme système de prestation efficace de l'enseignement. Car manifestement, elle jouera un rôle important en Afrique en général et au Gabon en particulier, mais ce rôle reste à définir.
Bibliographie
Rapport des pays. L'évaluation de l'éducation pour tous à l'an 2000. Téléaccessible à l’adresse : http://www2.unesco.org/wef/countryreports/gabon/rapport_1.html
Thomas Brinkhoff, (2003). La population Gabonaise : http://www.citypopulation.de/Gabon.html
Rapport sur l’enseignement supérieur au Gabon. Téléaccessible à l’adresse : http://www.coimbra-group.be/acp/doc/Rapport%20Gabon.pdf.
La situation des TIC dans le monde, téléaccessible à l’adresse : http://www.itu.int/ITU-D/ict/dai/material/DAI_ITUNews_f.pdf
Annie Cheneau-Loquay, Pour une stratégie de communication pour le développement. Les usages et les besoins en communication au Gabon : approche socio-économique exploratoire, mars, 2000. Article téléaccessible à l’adresse : http://diderot.rio.net/gabon/aloquay
Article téléaccessible à l’adresse : http://www.franconetcanada.org/gabon/acces.htm
Journal L’Union, mercredi 14 juillet 2004
Rapport de l’Institut de Recherche sur l’Économie de l’Education, CNRS et Université de Bourgogne, octobre 1999. Rapport réalisé à la demande et sur financement du Ministère français des Affaires Etrangères pour le compte du Ministère de l’Éducation National gabonais.
Rapport mondial sur le développement humain 1999, Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).
Extrait du discours prononcé par l’ancien Ministre de l’Éducation nationale, André Mba Obame, lors de la remise des ordinateurs aux proviseurs des lycées, Libreville, octobre 2001.
Journal l’Union, quotidien national, 22 octobre 2001.
OBONO MBA Anasthasie (2002). Les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement secondaire. Nouvelles menaces d'exclusion ou nouvelles chances pour les systèmes éducatifs des pays d'Afrique subsaharienne. Cas du Sénégal et du Gabon. Mémoire de DEA
Article téléaccesible à l’adresse : http://wwww.actu.voilà.fr/Depeche/depeche_informatique_041028131439.0rrn6820.html
Alain Mignot (2002). Rapport sur l’enseignement supérieur au Gabon. Téléaccessible à l’adresse : http://www.coimbra-group.be/acp/doc/Rapport%20Gabon.pdf.
Valérien J., Guidon J. Wallet J., Brunswic E., Enseignement à distance et apprentissage libre en Afrique subsaharienne francophone, Etats des lieux fin 2001, Resafad, janvier 2002.
RESAFAD-TICE (2003) Actes des rencontres sur l’usage des réseaux pour l’éducation en Afrique. Unesco. Paris : ADPF
Site du master UTICEF téléaccessible à l’adresse : http ://www.dessuticef.u-strabg.fr
Torres, R. M. 1995. Teacher education : from rhetoric to action. Document présenté lors de la Conférence sur Partnerships in teacher development for a New Asia, Unesco-Unicef, Bangkok, 6-8 décembre.
Annexe 1 : La carte du Gabon