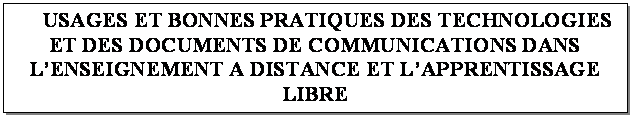
Nom : AWOKOU
Prénom : Kokou
Titre et fonction : Assistant, Chargé d’étude
Adresse : Centre de Formation à Distance – Université de Lomé
BP 1515 – Lome , Togo
Adresse électronique : kawokou@hotmail.com
Le Togo à l’instar des autres pays du continent s’ouvre à l’utilisation à l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication. Mais il faut relever que la première expérience d’utilisation des médias dans l’enseignement au Togo remonte aux années 1960. Au cours de cette période, des modules de formation à distance ont été conçus et dispensés pour le personnel des médias public (surtout les animateurs de radio). Plus tard une expérience intéressante de télé-enseignement sera menée dans l’enseignement primaire. C’est à partir de 1984 qu’avec la création de la DIFOP que sera menée avec succès une expérience originale de formation à distance permanente du personnel enseignant. Jusqu’à nos jours le Togo continue de mener d’autres expériences en matière de formation à distance.
La présente étude se propose de présenter les diverses expériences de formation menées tant dans le domaine de la formation à distance que dans la formation des enseignants.
I – Cadre sociétal et technique
Le Togo dispose actuellement de plusieurs médias pouvant servir de relais dans mise en place de dispositifs de formation ouverte ou à distance. Comme médias nous pouvons citer les radios, les télévisions, la téléphonie ainsi que Internet.
I1 - Stations de Radio
La première émission radiodiffusée remonte au 13 août 1953 à un moment où le Togo était encore sous le régime colonial. La chaîne nationale de radiodiffusion dénommée « Radio Lomé » dispose d’un émetteur de 20 kilowatts installé dans la banlieue de Lomé la capitale. Cette radio émettait en onde courte a couvert jusqu’à récemment la partie méridionale du Togo. Elle dispose depuis 1988 de deux émetteurs FM installés à l’intérieur du pays ; l’un à Agou et l’autre à Alédjo. Ces deux émetteurs FM permettent une couverture intégrale du territoire national.
Une seconde chaîne nationale de radio est installée depuis 1975 à Kara et couvre la région septentrionale. Cette chaîne appelée Radio Kara n’est pas une chaîne concurrente mais permet de diffuser des émissions réalisées dans ses studios installés à Kara, la seconde ville du Togo. Les deux chaînes de radios « Radio Lomé » et « Radio Kara » sont des chaînes publiques.
A partir de 1990, cette situation de quasi monopole exercé par ces deux radios sur les ondes au Togo va connaître un changement notable avec l’apparition de radios privées. Ces stations de radios profitant de la nouvelle réglementation autorisant l’exploitation des ondes nationales, vont proliférer. On compte actuellement 82 stations de radios privées et deux relais de radios internationales (RFI et Africa N°1). Une bonne partie de radios privées émettent à Lomé et dans sa banlieue. Néanmoins les 5 régions économiques disposent en moyenne de 10 stations de radios émettant en FM.
I2 - Chaînes de télévision
La première chaîne de télévision au Togo a débuté ses émissions en juillet 1973. Tout comme les chaînes nationales de radios publiques, la Télévision togolais dispose deux émetteurs relais à l’intérieur du pays. Ce qui permet une couverture de l’ensemble du territoire national. La Télévision togolais dispose de tous les équipements nécessaires pour la réalisation de ses programmes. Actuellement c’est l’unique chaîne de télévision qui couvre le territoire national.
A côté de cette chaîne publique, des stations de télévision privées ont vu le jour dans la capitale et dans sa banlieue. Nous pouvons citer la « Télévision Deuxième chaîne »(TV2), la « Télévision Septième Chaîne »(TV7), la « Radio Télévision Delta Santé », la « Télévision Zion » (une chaîne religieuse). Contrairement à la prolifération des stations de radios privées, l’installation de télévision privée connaît un moindre engouement.
I3 - Téléphonie
L’utilisation du téléphone au Togo remonte très loin dans le temps. Déjà au cours de la colonisation allemande, une ligne de communication reliait Lomé à Berlin. Plus tard, sous la tutelle française, un effort sera fait pour rendre populaire l’utilisation du téléphone.
Aujourd’hui, le secteur de la téléphonie fixe est géré par une société d’Etat dénommée « Togotélécom ». Cette société a su moderniser le réseau. Le réseau est actuellement entièrement numérisé en commutation et en transmission. Tous les nouveaux services sont offerts : RNIS, SDA, conférence à trois, identification de l’appelant, ….
Le réseau désert 136 localités et le parc s’élève à 70 000 ligne principales.
Le secteur de la téléphonie mobile a connu un essor assez important ces cinq dernières années. Deux opérateurs importants se partage le marché togolais. Il s’agit de « Togocel » qui est une filiale de « Togotélécom » et « Telecel » qui est un opérateur privée. Les deux sociétés couvrent le territoire national et offre plusieurs service : téléphonie mobile, SMS, Roaming. Par son service Roaming, Togocel est lié à plus de 30 pays. Togocel revendique 150 000 abonnés alors que Telecel qui est une société plus modeste, revendique 30 000 abonnés.
I4 - Internet
Internet a connu un essor fulgurant au Togo. Des données statistiques montrent que qu’en 2002, on chiffre à 200 000 le nombre des internautes au Togo, alors qu’il n’était que 10 000 internautes en 2000. Dans le secteur, la société Togotélécom joue un grand rôle. Elle s’est positionnée comme le plus grand fournisseur d’Internet. Elle offre des accès distants par le réseau commuté et des accès permanents à travers des liaisons spécialisées pouvant atteindre jusqu’à 512 Kbts. 17 fournisseurs d’accès commercialisent le service aux utilisateurs finaux. On recense plus de 300 cybercafés qui utilisent les services Internet de la Société. Plus de 85% des cybercafés sont dans la capitale.
Parallèlement une société privée dénommée « Café Informatique » offre des services Internet et gère le nom de domaine « tg ». Elle fut la toute première Internet Service Provider (ISP) Elle dispose de deux antennes VSAT en redondance avec une capacité de 1/3 Mbps. Elle fournit au Togo une expertise en matière d’Internet et d’Intranet. Plusieurs sociétés ont recours à ses services. Café informatique fournit les services suivants :
- Acces Provider
- Service Provider
- Solution Provider
I5 - Le Togo et la Fibre optique
Avec l’accroissement des nouveaux services dans les secteurs des télécommunications et de l’information, la demande de capacité de transmission s’est considérablement accrue. Pour faire face à un besoin croissant de débits tant pour les échanges de données que pour l’accès à Internet, Togotélécom s’est investit dans plusieurs projets d’amélioration de son réseau. En 1992, il a introduit dans ses réseaux des câbles à fibre optique qui permettent une meilleure transmission des données. Le Togo participe actuellement au grand projet d’interconnexion permettant l’accès aux réseaux sous-marins à fibres optiques SAT3/WASC/SAFE et AFRICA ONE LTD. Plusieurs pays du continent participent à ce projet qui, à terme, décuplera les capacités de communication des pays membres.
II – Institutions de formation des formateurs au Togo
Pour bien comprendre l’organisation et le fonctionnement des structures de formation des enseignants au Togo, il faut décrire le système éducatif togolais. En effet le système éducatif togolais est structuré en degrés d’enseignement. L’enseignement préscolaire et l’enseignement primaire relève du Premier Degré. L’enseignement secondaire (de la Sixième à la Troisième) relève du Second Degré. Le Troisième Degré comprend les classes de Seconde, Première et Terminal. Tous les établissements d’enseignement de niveau universitaire relèvent du Quatrième Degré.
La formation des enseignants au Togo se fait à travers plusieurs structures. Les Ecoles Normales des Instituteurs et l’Ecole Normale Supérieure forment les enseignants des Premier et Second Degré. La formation des professeurs exerçant dans le Troisième Degré et celle des conseillers pédagogiques et des inspecteurs sont assurées par l’Institut National des Sciences de l’Education qui est un institut universitaire rattaché à l’Université de Lomé. A ces deux structures s’ajoute la Direction de la Formation Permanente et de l’Action Pédagogique (DIFOP) qui a été créée pour assurer le recyclage et la mise à niveau des enseignants du Togo
II1 - La formation du personnel enseignant du Premier Degré
Le Personnel Enseignant exerçant dans le préscolaire est formé à l’Ecole de Formation des Jardinières d’enfants de Kpalimé. Cette structure a été créée pour faire fasse à la forte demande de formation de niveau préscolaire et surtout de l’option de faire du secteur de l’enseignement préscolaire un secteur important.
Jusqu’en 1980, la formation des instituteurs et des instituteurs adjoints stagiaires et celle des enseignants du Deuxième Degré ont été assurées par l’Ecole Normale Supérieure (ENS) situé à Atakpamé à 165 Km de Lomé. L’ENS avait en son sein deux structures, l’une orientée vers la formation des instituteurs et des instituteurs adjoints stagiaires et l’autre tournée vers la formation du personnel enseignant des Collèges d’Enseignements Général (CEG) qui relèvent du Deuxième Degré.
Mais avec l’accroissement des besoins d’encadrement, il a été créé deux écoles normales des instituteurs à Notsé et à Kara. Ces deux écoles ont permis la formation et le recyclage de plusieurs instituteurs dont avait besoin le Premier Degré du système éducatif togolais. La création de ces deux établissements a conduit l’Ecole Normale Supérieure d’Atakpamé à centrer son rôle sur la formation des professeurs des CEG.
II2 - La formation des professeurs de l’enseignement du Second Degré
La formation des professeurs exerçant dans le Second Degré est assurée par l’Ecole Normale Supérieure d’Atakpamé. Cette institution de formation de formateurs a été initialement orientée vers la formation des instituteurs et des professeurs du secondaire. Elle accueille actuellement des étudiants désirant devenir professeurs des CEG. L’entrée est subordonnée à un concours.
II3 - La formation des professeurs de Lycée, des conseillers pédagogiques et des inspecteurs
La formation des professeurs de Lycée est assurée par l’Université de Lomé à travers l’Institut National des Sciences de l’Education (INSE). Jusqu’en 1988 l’INSE et deux écoles universitaires avaient en charge la formation des professeurs de lycée. Ces écoles dispensaient des enseignements dans les différentes disciplines alors que l’INSE assurait la formation pédagogique des postulants. Ces deux écoles sont : l’Ecole des Lettres et l’Ecoles des Sciences. Les étudiants formés dans ces structures étaient destinés à l’enseignement du 3ème Degré c’est-à-dire les lycées.
La transformation des ces deux écoles en 1988 en facultés a conduit l’INSE à assurer seul la formation des professeurs de lycée à travers sa filière Formation des Professeurs de Lycée. Actuellement cette filière assure chaque année la formation d’une cinquantaire de professeurs de lycée.
L’INSE à travers sa filière Formation des Formateurs, assure en collaboration avec la DIFOP, la formation des inspecteurs des enseignements du 1er et 2ème Degrés ainsi que la formation des conseillers pédagogiques.
II4 - La Formation permanente des enseignants
La formation permanente et la mise à niveau des maîtres sont assurées par la Direction de la formation permanente et de l’action pédagogique (DIFOP). Cette direction importante a été créée en avril 1979 et a eu pour missions en collaboration avec l’Institut National des Sciences de l’Education de l’Université :
- d’assurer la formation permanente du personnel enseignants des 1er, 2ème et 3ème Degrés
- de faire la recherche pédagogique appliquée
- d’assurer l’adaptation permanente des méthodes et programmes d’enseignement au réalité et aux besoins du pays.
On peut mettre à l’actif de cette direction plusieurs actions et initiatives visant le recyclage et la mise à niveau des enseignants au Togo et surtout l’expérimentation de la formation à distance des enseignants.
III – Formation des enseignants dans le Primaire et le Secondaire
Créé en 1979, la DIFOP fut la première institution à initier une expérience fort intéressante de télé-enseignement orienté vers la formation des enseignants. Cette structure initia deux grands projets de formation de mise à niveau et de formation continue des enseignants au Togo
III1 - Programme de télé-enseignement au Togo
Le Ministère togolais de l’Education Nationale, avec le concours du PNUD, de l’UNESCO, de la Banque Mondiale et la Mission Française d’Aide et de Coopération a mis en place à la DIFOP, un vaste programme de formation et de perfectionnement des maîtres en cours d’emploi dans le Premier Degré. C’est une formation à distance qui combine trois médias : les cours par correspondance, une revue pédagogique dénommé « Le Lien » et des émissions radiophoniques. Le projet est financé par le Programmes des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et assisté techniquement par l’UNESCO.
Le Projet vise à élever le niveau de culture générale des maîtres en cours d’emploi de l’Enseignement du premier Degré et d’améliorer leur niveau professionnel. Le public visé était de 10 540 enseignants dont une grande majorité n’avait pas reçu de formation professionnelle initiale. L’enseignement reçu à travers ce programme devait préparer aussi les bénéficiaires aux stages dans les écoles normales d’instituteurs organisés et financés par un autre projet dénommé projet Education Togo/Banque Mondiale.
Les maîtres de l’enseignement du premier Degré inscrits à cette formation sont regroupé en plusieurs niveaux :
- le niveau I regroupe les moniteurs ayant fait les classes de cours moyens, de 6ème et de 5ème ;
- le niveau II regroupe ceux ayant le niveau 4ème et 3ème ;
- le niveau III pour les instituteurs adjoints stagiaires et les moniteurs candidats au Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique (CEAP)
- le niveau IV pour les instituteurs Adjoints candidats au CAP (Certificat d’Aptitude Pédagogique)
Le Cours par correspondance
Les cours portent sur quelques disciplines de base comme le Français, les mathématiques, la Psychopédagogie et les Sciences.
La première phase du projet de télé-enseignement a démarré en avril 1984 et est arrivée à expiration en juin 1987. La contribution du gouvernement togolais à ce projet était de 182 621 520 F CFA et celle du PNUD était de 581 056 dollars US. Le projet a bénéficié de l’assistance financière de la Banque mondiale et du Ministère français de la Coopération.
Au terme de la première phase qui a duré trois ans trois mois, 6 304 maîtres ont bénéficié des cours par correspondance dont 506 moniteurs expérimentateurs pour l’année scolaire 1983-1984, 2004 moniteurs permanents et adjoints pour les cours de niveau I et II pour l’année 1984 – 1985 et 1500 moniteurs permanents et adjoints pour les mêmes niveaux I et II pour l’année scolaire 1985 – 1986. La même année 397 moniteurs adjoints et instituteurs adjoints stagiaires ont bénéficié des cours de niveau III. Pour l’année scoalire 1986-1987 1450 moniteurs permanents et adjoints ont bénéficié des cours des niveaux I et II et 800 moniteurs et instituteurs adjoints stagiaires ont bénéficié des cours de niveau III.
Au total 70 550 dossiers de cours et 243 360 corrigés-types de devoirs ont été produits et distribués aux apprenants et à leurs encadreurs.
La radio éducative
Les émissions radiophoniques étaient conçues pour appuyer et renforcer les cours par correspondance. Deux rubriques d’émission étaient conçues. Il s’agit des rubriques « L’école et nous » et « L’heure du maître ». Dans le cadre de ces deux rubriques 199 émissions radiophoniques ont été produites par la DIFOP et des collaborateurs extérieurs et diffusées sur les deux chaînes nationales de radio (Radio Lomé et Radio Kara).
Les apprenants et les directeurs étaient invités à suivre ces émissions et à en débattre lors des séances d’animation pédagogique et à envoyer leurs observations et suggestions à la DIFOP pour une amélioration des contenus des émissions.
La revue pédagogique le « Lien »
La revue a disposé d’une banque d’articles et a édité 6 numéros tirés à 40 500 exemplaires au cours de la période 1984-1985. les apprenants inscrits devaient souscrire un abonnement obligatoire à la revue qui est un complément indispensable aux dossiers des cours par correspondance.
L’encadrement
Pour assurer l’encadrement du télé-enseignement, la DIFOP a organisé 16 stages de formation d’août 1984 à juillet 1986 à l’attention de 1400 directeurs d’école, 40 inspecteurs et 100 conseillers pédagogiques de l’enseignement du premier Degré et 30 professeurs d’Ecole normale d’instituteurs.
De 1985 à 1987, six séminaires ont été organisés à l’intention des inspecteurs, des conseillers pédagogiques, des professeurs des écoles normales d’instituteurs. Ces rencontres ont porté sur les langues nationales, l’Animation pédagogique et les techniques d’élaboration des curricula. 437 personnes ont bénéficié des ces formations.
Le projet de Télé-enseignement devait connaître sa second phase compte tenu des résultats obtenus à la première phase. Cette deuxième phase devait permettre la formation des instituteurs et des instituteurs adjoints candidats au CEAP et au CAP, la formation permanente du personnel d’encadrement (directeurs d’école, conseillers pédagogiques inspecteurs, professeurs d’école normale des instituteurs et des cadres de la DIFOP). A terme cette seconde phase devait permettre la mise en place d’un système permanent de télé-enseignement multimédia à Lomé pour élever le niveau des connaissances générales et professionnelles des maîtres de l’enseignement du premier Degré. Malheureusement cette seconde phase n’a pas connu un début d’exécution compte tenu de la conjoncture sociopolitique que le Togo a connu à partir de 1989.
Néanmoins un second programme de formation à distance des chefs d’établissement sera initié par la Direction de l’enseignement du premier Degré du Togo et le RESAFAD.
III2 - Programme de formation à distance des directeurs d’école
Pour faire face aux besoins de formation des acteurs du système éducatif, le Togo, à l’instar des certains pays francophones membres du Réseau Africain Francophone de formation à distance (RESAFAD) a eu à faire recours à la formation à distance et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour opérer la formation des directeurs d’école de l’enseignement du Premier Degré.
Phase préparatoire
La phase préparatoire dudit programme a permis la définition du cadre institutionnel du projet, l’élaboration d’un référentiel de formation, la formation des formateurs, l’élaboration et la validation des modules de formation et enfin la production et la distribution des supports.
Une lettre circulaire en date du 25 juillet 1997 signé du Ministre de l’Education Nationale définit les orientations du projet et les dispositifs réglementaires consécutives à la formation et place le projet sous la responsabilité de la Direction de l’enseignement du Premier Degré. Un arrêté est venu préciser les missions des équipes et des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ladite formation. Plusieurs équipes sont alors formées. Il s’agit de :
- l’équipe de gestion et de coordination
- l’équipe technique de validation
- l’équipe de conception et de réalisation des modules
- l’équipe des tuteurs
- l’équipe des gestionnaires des centres de ressources des régions
Un planning a été élaboré fixant les tâches dévolues aux différentes équipes.
Un travail préliminaire a consisté en la collecte et en l’analyse des textes en vigueur, en la collecte des informations sur les besoins des directeurs d’école et en un sondage auprès du personnel d’encadrement (inspecteurs et conseillers pédagogiques). De l’analyse des résultats de ce travail préliminaire, il s’est dégagé un ensemble d’orientations relatives au programme de formation à mettre en place. Le document élaboré porte sur :
- le rôle pédagogique du directeur d’école
- le rôle administratif du directeur d’école
- le rôle relationnel et social du directeur d’école.
Sur la base des trois domaines susmentionnés, des thèmes en rapport avec les besoins de formation des bénéficiaires ont fait l’objet de séquences de formation.
21 séquences de formation ont été élaborées et regroupée dans 8 livres. Les séquences élaborées ont fait l’objet d’une expérimentation auprès d’un échantillon de directeurs d’école.
Les différents acteurs impliqués ont été formés. Ainsi les membres de l’équipe de gestion et de coordination ont été formés à la gestion de la FAD puis initiés à la bureautique et à l’utilisation de la messagerie électronique. Ceux de l’équipe de conception et de réalisation des séquences ont été formés à la méthodologie de la FAD, à la bureautique et initiés à l’utilisation d’Internet. L’équipe des tuteurs a été formée au rôle de tutorat de la FAD. Quant aux gestionnaires des centres de ressources régionaux, leur formation a porté sur la gestion de la FAD et l’utilisation de outil informatique (Word et Excel).
Selon les prévisions initiales, il était prévu une mise en ligne des contenus des modules afin de les rendre accessibles pour impression dans les centres de ressources. Mais ce schéma initial n’a pas pu se réaliser compte tenu du fait que certains centres de ressources ne disposent pas de connexion Internet. Il a fallu imprimer les livrets portant sur les différents modules de formation et procéder à leur distribution auprès des apprenants.
Formation
La formation proprement dite a connu deux phases :
- la phase expérimentale qui a début en mars 1997 avec la formation de 250 directeurs retenus sur deux sites et limitée aux inspections pédagogiques relevant de Lomé, la capitale et de Kara, la seconde ville du Togo.
- la phase de généralisation qui a démarré en septembre 1998 avec la formation des directeurs d’école relevant des autres inspections pédagogiques de l’enseignement primaire du pays.
Les deux phases de formation ont duré deux années académiques (dix-huit mois). L’approche qui a été privilégié fut l’approche centrée sur l’apprenant fondée sur l’autoformation assistée et le travail de groupe réel ou virtuel. La stratégie de formation a été celle de l’autoformation avec des regroupements périodiques pour les tutorats et les évaluations. Le support utilisé fut le papier.
La gestion et l’administration du dispositif de formation se sont opérées à trois niveaux :
- au niveau national par l’équipe de la cellule de gestion et de coordination
- au niveau régional par les équipes des gestionnaires des centres de ressources régionaux
- au niveau de s inspections par l’inspecteur.
La validation de la formation s’est faite à travers des mesures incitatives accordant des avantages professionnels aux bénéficiaires de la formation. Les conditions de jouissance de ces avantages étaient :
- faire preuve d’assiduité aux différents regroupements
- traiter les exercices et devoirs proposés
- recevoir une appréciation positive pendant et en fin de formation
- être soumis, en fin de formation à un entretien avec un jury.
Résultats de la formation
Bien que le programme n’est pas fait l’objet d’une évaluation systématique, on a pu relever une satisfaction de la part des initiateurs et des gestionnaires du programme. En outre 93,3% des directeurs d’écoles ayant suivi la formation ont satisfait aux épreuves d’évaluation.
Le programme a permis la formation en deux ans 2183 directeurs d’école sur un total de 2397 directeurs en poste à cette époque soit 91%. A cela vient s’ajouter d’autres acquis qui méritent d’être mentionnés. Il s’agit de :
- la formation de 11 concepteurs de séquence de formation de FAD
- la formation de 5 cadres nationaux pour la validation des modules de FAD
- la formation de 90 tuteurs
- la formation de 12 gestionnaires de ressources
- l’élaboration de 21 séquences de cours réparties en 8 livres.
Perspectives
Plusieurs perspectives s’offrent à ce programme. La première est d’étendre la formation à l’ensemble de directeurs des écoles de l’enseignement public et à ceux des enseignements confessionnel et privé laïc. La seconde perspective est de réaliser la forme numérisée des modules de formation sur CD-ROM et mettre en ligne ladite formation sur un site. Une piste à explorer est celle de prospecter des financements dans le cadre du projet EPT (Education Pour Tous).
Perspectives dans l’enseignement primaire et secondaires
Le Fonds Japonais se propose de financer dans les trois années à venir un programme d’appui à l’amélioration de la qualité de l’éducation au Togo. Ce programme vise le renforcement de la qualité dans l’ensemble du système éducatif, la contribution à l’élévation du niveau du corps enseignant et des personnels d’encadrement dans les Premier, Deuxième et Troisième Degrés de l’enseignement. Le programme comporte trois volets.
Volets |
Désignation |
Coût |
1 |
Appui à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité dans l’enseignement du Premier Degré (éducation de base) |
485 000 $ US |
2 |
Appui à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité dans l’enseignement secondaire (collèges et lycées) |
670 000 $ US |
3 |
Appui à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité dans l’enseignement supérieur |
226 500 $ US |
Total |
1 381 500 $ US |
IV – Identification d’usages originaux ou de pratiques spécifiques dans l’éducation pré universitaire
Plusieurs établissements privés préparant le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) tentent d’offrir des enseignements en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Les enseignements assurés par ces établissements porte sur la maîtrise de l’utilisation de l’outil informatique. Ainsi nous avons pu répertorier des modules de formations sur l’Informatique de gestion, la Bureautique, l’Administration de Réseaux, La Maintenance informatique, Les Télécommunications, etc. nous avons pu trouver chez les responsables des établissements du pré universitaire, le besoin d’utiliser les technologies de l’information et de la communication comme médias d’enseignement. Mais les coûts de connexion rendent difficile toutes initiatives dans ce domaine. Seul un établissement a pu se doter d’un VESAT pour recevoir des enseignements dispensés dans le cadre d’un partenariat avec une école située à Dakar au Sénégal.
En effet l’Ecole Supérieure d’Informatique de Business et d’Administration (ESIBA) assure des enseignements donnés par l’Ecole Supérieure Multinationale de Télécommunications qui est située à Dakar. Les étudiants togolais inscrits à ces cours recevoir des enseignements par visioconférence. Pour faciliter l’organisations de ces cours, ESIBA s’est doter d’un dispositif VESAT lui permettant de d’assurer le relais des enseignements dans ses locaux à Lomé.
A brève échéance, cette expérience pourra faire des émules dans l’enseignements pré universitaire qui connaît est actuellement un grand engouement au Togo.
VI – Formation dans l’enseignement supérieur
Diplôme Universitaire de Communicateur Multidédias
En 1998 a démarré une formation en ligne de communicateur multimédias à l’Université de Lomé. Cette formation a pour but d’apporter la culture et des techniques nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans un contexte professionnel. Cette formation a pour cadre la collaboration entre l’Université de Lomé et l’Université du Maine et l’appui financier et technique du Réseau Africain Francophone de Formation à Distance (RESAFAD).
La formation est destinée aux institutionnels, aux formateurs du milieu éducatif, aux professionnels et aux étudiants. Il s’agit par cette formation d’assurer la diffusion des NTIC dans le milieu national en faisant de sorte que les formés deviennent des personnes ressources chargées de promouvoir et de favoriser la diffusion et la mise en œuvre des TIC dans tous les milieux.
Organisation
La formation est réalisée à distance. Des regroupements sont organisés et réalisés par l’Université de Lomé. Ces regroupements permettent de s’assurer du bon déroulement de la formation et de procéder à la validation. Une assistance et des ressources locales sont mises à la disposition des apprenants. Il existe deux type de tutorat : un tutorat local et un tutorat à distance. Cette organisation permet aux étudiants d’avoir en permanence un interlocuteur. Les échanges se font à travers la plate-forme de formation accessible par Internet.
La formation comprend environ 325 heures dont 65 heures de regroupement. Elle se déroule en dix mois. Les dates des regroupements son définies pour chaque session. La formation tient compte du parcours de chaque apprenant et de leurs impératifs professionnels.
Chaque stagiaire doit disposer d’une station de travail micro informatique avec un accès Internet. Les logiciels suivants sont nécessaires à la formation : Word, Excel, Publisher, Toolbook. Le Resafad a mis à la disposition de l’Université de Lomè une salle de travail informatique pour faciliter les regroupements et les autoformations.
Contenus
Le programme de formation comporte cinq modules. Le premier module intitulé « Parcours différenciés » permet une mise à niveau des étudiants inscrits. Les inscrits peuvent faire le choix de séquences leur permettant de compléter leurs connaissances dans un domaine donné. Le second module est intitulé « Concept de traitement de données informatisées » Les enseignement à ce niveau porte sur la bureautique et la maîtrise des logiciels de traitement de texte (WORD) de traitement de données numériques (Excel) et de traitement des images (Photoshop). Le troisième module porte sur Internet et les hypermédias. Il s’agit par ce module de faire acquérir aux apprenants des compétences dans l’utilisation des instruments permettant la conception des pages HTML et de s’initier à la conception et à la réalisation de site et CD-ROM. Le quatrième module porte sur la gestion et la mise en œuvre des projets multimédias. Ce module leur donne des connaissances sur les étapes du processus de gestion de projet et de mieux se connaître les contraintes d’un projet multimédias. Ce module permet à l’étudiant de concevoir sa propre démarche et d’identifier les étapes, les moyens et les contraintes liés à la réalisation du projet qu’il pourra présenté à la fin de sa formation. Le cinquième module est consacré à la réalisation d’un projet multimédias (conception de site ou de CD-ROM…) par les apprenants.
Encadrement de la formation
L’encadrement des apprenants se fait à deux niveaux. Au niveau local c’est-à-dire dans son université d’origine, l’apprenant dispose d’un tuteur qui l’aide et l’accompagne dans sa formation. Dans le cadre local, il est organisé des regroupements auxquels doit prendre part l’apprenant. Au cours de ces regroupements des enseignants échangent avec les apprenants des difficultés qu’ils éprouvent dans l’appropriation des connaissances. C’est aussi au cours de ces regroupements que sont effectuées les évaluation.
En outre, les apprenants disposent d’un tutorat distant permettant de les aider au cas ou le tutorat local ne peut pas fournir les réponses aux attentes des apprenants. Les échanges entre le tuteur distant et les apprenants se font à travers deux espaces organisés sur le site Internet de la formation. L’espace forum et l’espace chat. Ces deux espace d’échange viennent compléter la messagerie électronique disponible sur le site.
Validation
La validation des connaissances se fait à plusieurs niveaux. Le premier niveau est celui de la fréquence d’accès au site. Un tableau disponible sur le site permet au tuteur de savoir le nombre de fois où l’apprenant a « visité le site » et la durée de connexion. Le second niveau est ce lui de la présence aux regroupements et la réussite aux évaluations organisées aux cours de ces regroupements. Le dernier niveau est celui de la présentation d’un projet réalisé par l’apprenant. Ce projet est sanctionné par un jury composé de personnes venant de l’université de Lomé et de celle du Maine.
Résultats
De 1998 à 2003, soixante-quatorze ont bénéficié des la formation en DUCM. 56 ont réussi a avoir le diplôme de communicateur multimédias codélivrés par les deux universités.
Année |
Inscrits |
Admis |
Taux d’abandon (%) |
Taux de Réussite (%) |
1998 - 1999 |
9 |
9 |
0 |
100 |
2000 - 2001 |
12 |
11 |
8 |
92 |
2001 - 2002 |
25 |
15 |
40 |
60 |
2002 - 2003 |
28 |
21 |
25 |
75 |
Total |
74 |
56 |
24 |
76 |
Perspectives
Le projet qui a servi de cadre d’organisation de ladite formation est arrivé à terme en avril 2004. Depuis cette date, le RASAFAD qui appui matériellement et financièrement la formation s’est désengagé du projet. L’Université de Lomé envisage poursuivre seule la formation en l’améliorant ou dans le cadre d’un partenariat avec l’Université du Maine ce qui est actuellement à l’étude.
Agence Universitaire de la Francophonie et le Centre Numérique Francophone de Lomé
L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) à travers son Centre Numérique Francophone propose un ensemble de formations à distance. Elle offre des allocations d’études aux meilleurs candidats sélectionnés. Afin de faciliter la formation des étudiants inscrits dans ces formations à distance, l’AUF a créé à l’université de Lomé un campus numérique. Ce campus numérique dispose actuellement d’un important parc de micro-ordinateurs (cinquante ordinateurs) et d’une connexion Internet permanente. Ce dispositif permet d’offrir plusieurs services aux étudiants et aux enseignants de l’université de Lomé. On peut citer comme services offerts : la messagerie, la consultation de documents numérisés (Thèses, mémoires, livres…) et la formation à distance.
Les formations offertes dans le cadre de ce campus numérique portent sur plusieurs disciplines (Droit, Médecine, Biologie, Education…). On y trouve des formation de trois cycles universitaires (premier, deuxième, troisième cycles). Ces formations sont le plus souvent organisées par des universités du Nord membres du réseau des universités de l’espace francophone. Dans ce campus numérique, les étudiants trouvent toutes les infrastructures techniques pouvant les aider dans la poursuite de leur formation.
La totalité des formations sont dispensées entièrement à distance et les examens organisés de façon classique. Les diplômes proposés ont la même valeur que les diplômes classiques. La majeure partie des formations proposées conduit à l’obtention de diplôme d’état.
Les objectifs de l’AUF à travers ces campus sont entre autre la promotion de l’introduction des technologies éducatives dans les pratiques pédagogiques des enseignants et le renforcement et la modernisation des formations par l’introduction de modules utilisant des supports numériques.
Perspectives dans l’enseignement supérieur
Dans le cadre du Fonds japonais, il est prévu un appui à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité dans l’enseignement supérieur. Ce programme prend en compte :
- la finalisation des thèses et le recyclage des enseignants de l’Université de Lomé
- la formation du personnel de l’enseignement supérieur
- la formation du personnel de bibliothèque
- le renforcement des NTIC
- le renforcement de la recherche au service de la qualité de l’éducation.
Le coût de ce programme est évalué à 226 500 dollars US.
Parallèlement, l’UNESCO se propose d’apporter un appui au renforcement de l’enseignement supérieur. Ce programme comporte :
- la formation de formateur dans une université du Nord
- la formation de formateurs dans une université du Sud
- la formation de formateurs à l’université de Lomé
- le perfectionnement des anciens enseignants
- l’appui aux équipes de recherches
- la formation des enseignants du 3ème Degré
- l’appui à la bibliothèque centrale de l’université de Lomé
Ce programme d’appui à l’enseignement supérieur est évalué à 130 000 dollars US.
VII - Conclusion
En définitive, l’expérience togolaise en matière d’utilisation des médias dans l’enseignement de façon générale et particulièrement dans la formation des formateurs est riche. De l’utilisation de la radio, à celle des technologies de l’information et de la communication en passant par l’audiovisuel, nous pouvons dire que les différents médias ont servi d’instruments dans l’enseignement. Les différents programmes qui ont permis l’utilisation des ces médias ont permis aussi l’accumulation d’une expertise nationale que le Togo peut revendiquer. Néanmoins, le manque de continuité dans les expériences entreprises et surtout la situation socioéconomique que le Togo a connu depuis bientôt quinze années n’ont pas permis une meilleure rentabilisation des efforts consentis. Ainsi plusieurs programmes ou projets qui devaient connaître des phases supplémentaires ont pris fin faute de moyens. C’est le cas de programme de télé-enseignement, de la formation des directeurs d’école.
Bibliographie
- L’enseignement supérieur à distance en Afrique, vue générale et annuaire des programmes, Roberts et Associés, Toronto EDEA, 1998
- L’usage des réseaux pour l’éducation en Afrique, Actes des rencontres RESAFAD-TICE, Paris UNESCO, 2003
- Enseignement à distance et apprentissage libre en Afrique subsaharienne, état des lieux dans les pays francophones, Jean Valérien et collaborateurs, Paris, ADEA 2001
- Le système éducatif togolais, éléments d’analyse pour une revitalisation, Rapport du Ministère de l’Education nationale et de la Recherche, Lomé, Mars 2002
- Bilan des activités 1986-1987 et projets 1987-1988, Direction de la Formation Permanente de l’Action et de la Recherche Pédagogiques, Lomé juin 1987
- Avant projet pour l’amélioration de la qualité de l’éducation dans le système éducatif togolais par le renforcement des capacités dans le domaine des ressources humaines (Document de travail, Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche)
Webographie
- Les médias d’Etat
http://www.gouvernement.tg/medias/radio.htm
- Le système de transmission à fibres optiques dans le réseau de TogoTELECOM
http://www.togotel.net.tg/html/grdprojets.html
- Togo – population internaute
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=to&v=118&1=fr
- Les stations de radios au Togo
http://www.republicoftogo.com/fr/news/print.asp?newsID=5999&languageID=1
- Lancement d’un chantier de pose de fibres optiques
http://www.africacomputing.org/breve106.html
- Cotonou : inauguration du câble sous-marin à fibre optique
http://www.africacomputing.org/breve53.html
-Enjeux des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour l’Afrique
http://membres.lycos.fr/mediaafriq/enjeuxntic.html?
- AISI-Connect National ICT Profil Togo(TG)
http://www2.sn.acp.org/africa/countdet.CFM?contries_ISO_Code=TG
- Ecole Supérieure Multinationale de Télécommunication